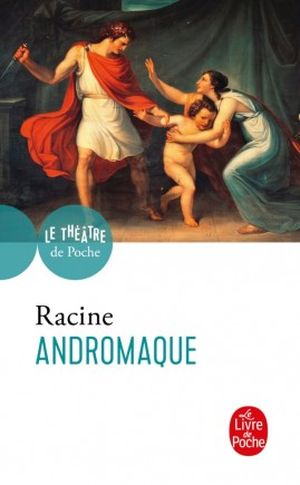En 1667, Jean Racine fait représenter Andromaque, sa troisième tragédie, et son premier grand succès. Inspirée de l’Énéide de Virgile, de l’Andromaque d’Euripide et des Troades de Sénèque, la pièce transpose sur la scène classique un récit mythologique, suivant la guerre de Troie. La tragédie est construite sur une chaîne d’amours contrariés : Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector (qui est mort). Ce réseau sans issue inscrit chaque personnage dans une logique de frustration.
Comme l’indique le titre, Andromaque est l’héroïne de l’histoire, confrontée à un chantage cruel : épouser son geôlier, le roi Pyrrhus (meurtrier de son mari Hector), ou voir mourir son fils Astyanax, dernier héritier de Troie. Doit-elle sauver son fils au prix de sa fidélité conjugale et politique, ou bien rester fidèle à son peuple et à la mémoire d’Hector, mais condamner son enfant ?
De sa décision ne dépend pas seulement la vie de son fils, mais aussi le destin de tous les autres personnages : si elle refuse Pyrrhus, celui-ci reviendrait à Hermione, tandis que si elle l’accepte, Hermione reviendrait à Oreste. Ainsi, tout en en étant captive et sujet au chantage, Andromaque possède un grand pouvoir. Roland Barthes, dans son ouvrage Sur Racine, décrit “la division du monde racinien en forts et en faibles, en tyrans et en captifs”. Or c’est ici l’esclave, la captive (Andromaque) qui est forte, et les tyrans qui sont faibles—qui dépendent de sa décision, et, contrairement à elle, cèdent à leur passion.
En effet, si Andromaque est une héroïne morale, c'est avant tout car, dans l’antagonisme amour-devoir, elle ne se laisse pas emporter par ses passions comme les autres personnages. Pyrrhus oublie son devoir, l’intérêt des Grecs et son engagement auprès d’Hermione ; Hermione, par jalousie, se venge de Pyrrhus puis se suicide de désespoir ; Oreste est prêt à enlever Hermione et lui obéit aveuglément.
---
Dans le but de représenter le caractère symbolique du choix d’Andromaque, Racine réécrit la tragédie antique, dans laquelle Andromaque a eu un enfant avec Pyrrhus et est ensuite mariée à un autre homme (après que Pyrrhus l’ait abandonnée pour Hermione) : “Andromaque ne connaît point d’autre mari qu’Hector, ni d’autre fils qu’Astyanax. J’ai cru en cela me conformer à l’idée que nous avons maintenant de cette princesse. La plupart de ceux qui ont entendu parler d’Andromaque ne la connaissaient guère que pour la veuve d’Hector et pour la mère d’Astyanax. On ne croit point qu’elle doive aimer ni un autre mari, ni un autre fils. Et je doute que les larmes d’Andromaque eussent fait sur l’esprit de mes spectateurs l’impression qu’elles y ont faite, si elles avaient coulé pour un autre fils que celui qu’elle avait d’Hector.”
Ainsi, dans l'univers racinien, Andromaque est un symbole de fidélité, d’exclusivité : elle est la veuve d’un homme et la mère d’un enfant. En préservant la chasteté d’Andromaque (le mariage avec Pyrrhus n’est même pas consommé), Racine privilégie la pureté morale de son héroïne et l’idéalise comme veuve et comme mère.
Pourtant, Barthes approfondit l’analyse en soulignant un paradoxe : comment toute une critique a-t-elle pu voir en Andromaque la figure idéale d’une mère, tandis qu’elle est définie exclusivement par sa fidélité à Hector ? En effet, Astyanax n’est pour elle que l’image d’Hector : “Ce fils, ma seule joie, et l’image d’Hector ? Ce fils, que de sa flamme il me laissa pour gage”. Son amour pour Astyanax lui a d’ailleurs été commandé par son mari : “Si d’un heureux hymen la mémoire t’est chère, Montre au fils à quel point tu chérissais le père”. C’est le souvenir de ce commandement d’Hector qui la décide d'ailleurs à épouser Pyrrhus dans l’acte IV (après avoir hésité pendant trois actes). Barthes écrit à propos d'Andromaque : “Son conflit n’est pas celui d’une épouse et d’une mère, il est celui qui naît de deux ordres contraires émanés d’une même source : Hector veut à la fois vivre comme mort et comme substitut, Hector lui a enjoint à la fois la fidélité à la tombe et le salut du fils parce que le fils c’est lui : il n’y a en fait qu’un même Sang, et c’est à lui qu’Andromaque doit être fidèle.” L’assimilation du fils à l’époux est d’ailleurs extrêmement étroite : “Il m’aurait tenu lieu d’un fils et d’un époux. (I, 4.)”, affirme Andromaque.
Pour échapper au dilemme, Andromaque met en place un "innocent stratagème", qui lui permettrait de concilier son devoir d’épouse et sa responsabilité de mère : elle compte épouser Pyrrhus, puis se suicider. Ce stratagème n’est pas si innocent que ça, car il déchaînerait vraisemblablement le malheur de tous (même Astyanax). Andromaque offre à Pyrrhus un marché factice, sachant qu’elle ne respectera pas sa part du contrat : en mourant, elle ne lui laissera d’épouse que son nom et son cadavre. Comment être sûre que Pyrrhus ne tuera pas Astyanax, une fois qu’il aura été trahi par Andromaque ? Andromaque offre deux raisons : la promesse qu’il lui a faite (“Pyrrhus en m’épousant s’en déclare l’appui ; Il suffit : je veux bien m’en reposer sur lui. Je sais quel est Pyrrhus : violent, mais sincère, Céphise, il fera plus qu’il n’a promis de faire") et sa fierté, qui sera piquée par la demande des Grecs qu’il rende le fils d’Hector (“Sur le courroux des Grecs je m’en repose encor : Leur haine va donner un père au fils d’Hector”). Toutefois, quelle est la valeur de la promesse d’un homme qui a brisé son serment à Ménélas et déshonoré sa fiancée, trahi son alliance avec les Grecs en décidant d’épouser une Troyenne ?
En réalité, le choix d’Andromaque met en péril la vie d’Astyanax. Et même si Pyrrhus décidait de ne pas tuer Astyanax, serait-il heureux? Il réaliserait bien un jour “[q]ue Pyrrhus est son maître, et qu’il est fils d’Hector.” (Cela est justement la contradiction à laquelle Andromaque tente d’échapper). Lorsqu’elle demande à Céphise de veiller sur lui, sa conclusion est égoïste : “J’irai seule rejoindre Hector et mes aïeux.”
Or, à la fin de la pièce, un retournement inattendu vient bouleverser l’issue tragique orchestrée par Andromaque : Pyrrhus est assassiné par Oreste (sur ordre d’Hermione, ordre que celle-ci regrette par la suite) juste après le mariage. Pylade annonce : "Andromaque elle-même, à Pyrrhus si rebelle, Lui rend tous les devoirs d’une veuve fidèle, Commande qu’on le venge, et peut-être sur nous Veut venger Troie encore et son premier époux."
Ainsi, suite au mariage et à la mort de Pyrrhus, Andromaque et son fils sont redevenus maîtres de leur destin. C’est une fin qui donne presque l’impression d’échapper au tragique : tandis que les trois autres personnages connaissent un destin terrible (Pyrrhus est tué, Hermione se suicide, Oreste devient fou), Andromaque est sauvée (et triomphe même politiquement !). Astyanax survit également, couronné par Pyrrhus “roi des Troyens” (et non des Épirotes, c’est-à-dire que son identité de Troyen et fils d’Hector demeure intacte). Toutefois, l’identité d’Andromaque est remise en question : elle est présentée par Pylade comme “veuve fidèle” de Pyrrhus, définie par sa fidélité à son nouveau mari. Son infidélité à Hector et à Troie est peut-être la plus grande tragédie pour elle—pire que la mort.