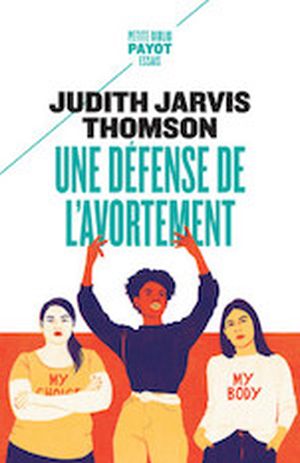Avant d’entrer dans le cœur de l’argument de Thomson, il est utile de rappeler ce qu’est un raisonnement analogique. Il s’agit de comparer deux situations présentant des traits communs et suggérer que, puisque A ressemble à B sur certains points, il est probable qu’A ressemble à B sur d’autres. C’est une forme de raisonnement inductif : il ne démontre pas avec certitude, mais rend une conclusion probable en fonction de la force des similarités. Un exemple simple : « Cette moto et cette voiture ont toutes deux un moteur et nécessitent du carburant. Une voiture a besoin d’entretien régulier. → Il est probable que la moto aussi ait besoin d’entretien régulier. »
La voiture et la moto sont similaires de manière pertinente : ce sont toutes deux des véhicules motorisés, mécaniques, soumis à l’usure. Étant donné ces caractéristiques partagées, il est raisonnable d’extrapoler d’autres similarités — comme le besoin d’entretien.
Mais attention : toutes les analogies ne sont pas pertinentes. Comparer un grille-pain et un ordinateur (tous deux branchés sur secteur) n’autorise pas à conclure que, comme le grille-pain, l’ordinateur fait des toasts. L'ordinateur et le grille-pain partagent une caractéristique triviale (branchables), mais diffèrent sur la fonction pertinente.
Or, même dans une bonne analogie, il existe des disanalogies — des dissemblances. Deux choses ne peuvent pas être semblables en tout point. La question est donc : les différences sont-elles assez importantes pour invalider l’analogie ?
De nombreux débats éthiques reposent sur ce type d’arguments par analogie : Singer et l’enfant qui se noie (analogie pour l’aide humanitaire), Locke et le gland qui devient un chêne (identité personnelle), et, dans le cas de Thomson, le célèbre exemple du violoniste.
Dans cet essai, Thomson propose le scénario suivant : vous vous réveillez relié de force à un violoniste malade, dont la survie dépend de votre corps. Le violoniste est incontestablement une personne ; pourtant, pour Thomson, cela n'implique pas que nous ayons l’obligation morale de rester attachés à lui, même si le débrancher entraîne sa mort. Le fait que le violoniste ait besoin de l’usage continu de vos reins ne lui confère pas le droit à cet usage. Personne n’a le droit d’utiliser vos reins sans votre consentement ; si vous l’y autorisiez, il s’agirait d’un acte de grande générosité — mais ce n’est pas quelque chose qu’il peut revendiquer comme un dû. Thomson insiste ainsi sur la nécessité de différencier ce qui relève du louable — ce qui serait « bien » ou moralement admirable — et ce qui est véritablement exigible, moralement et/ou légalement. Or, le fait qu’un geste soit admirable ne le rend pas obligatoire.
Ainsi, si nous jugeons moralement légitime (bien que peu admirable) de nous détacher de ce violoniste, pourquoi devrait-il en aller autrement de la grossesse ? Pourquoi une femme enceinte ne pourrait-elle pas « débrancher » le fœtus ? Ce n’est pas parce que le maintien d’une grossesse peut être vu comme une conduite généreuse, qu’il en découle une obligation d’y consentir.
L'argumentation de Thomson est radicale, parce qu'elle ne soutient pas simplement que le droit de la femme à disposer de son corps l’emporte sur le droit à la vie du fœtus. Pour elle, il n’y a même pas de conflit : le droit à la vie du fœtus ne comprend pas, en lui-même, le droit d’utiliser le corps de la femme pour survivre. Autrement dit, « se débrancher » du violoniste ne viole pas son droit à la vie, car ce droit à la vie n’inclut pas le droit d’être maintenu en vie par une tierce personne.
L’originalité de Thomson est donc d’avoir déplacé le débat de la question du statut du fœtus (est-il une personne ? a-t-il un droit à la vie ?) vers celle de l’autonomie corporelle. Elle accepte, pour les besoins de l’argument, que le fœtus soit une personne avec un droit à la vie. Mais elle démontre que ce droit n’implique pas celui d’utiliser le corps d’autrui. Ainsi, la question devient : peut-on exiger d’une personne qu’elle serve de machine de survie à une autre, simplement parce qu’elle est la seule à pouvoir le faire ? Pour Thomson, la réponse est non. Et c’est ce qui fonde la légitimité morale de l’avortement.
Une objection pouvant être faite à l’analogie du violoniste de Judith Jarvis Thomson consiste à dire qu’elle ne s’applique véritablement qu’aux cas de grossesse résultant d’un viol. En effet, dans le scénario imaginé par Thomson, la personne se réveille connectée au violoniste sans avoir donné son accord : elle a été kidnappée et branchée de force. Cette absence totale de consentement est ce qui fonde l’intuition morale selon laquelle il serait légitime de se débrancher. Or, selon cette objection, la plupart des grossesses sont issues de rapports sexuels consentis. Thomson anticipe cette objection selon lequel consentir à un rapport sexuel équivaut à consentir à une grossesse potentielle, et elle y répond encore en recourant à des analogies. Elle soutient que le fait d’utiliser une contraception constitue une forme de refus de donner au fœtus la permission d’occuper le corps. Elle compare par exemple l’acte d’aérer une pièce en ouvrant une fenêtre : si un cambrioleur en profite pour entrer, il serait absurde de dire que la personne a implicitement autorisé sa présence. Si des barreaux ont été installés pour empêcher toute intrusion et qu’un voleur réussit à passer en raison d’un défaut dans ces barreaux (analogie de la contraception), l’argument est encore plus absurde.
Mais que dire des cas où aucune contraception n’est utilisée ? Thomson n'a aucune réponse à nous apporter ici. Tournons-nous alors vers la philosophe Maggie Little, qui souligne ici une distinction cruciale : consentir à une activité risquée n’équivaut pas à consentir à supporter toutes les conséquences possibles si le risque se réalise. « Assumer le risque d’une grossesse n’est pas la même chose que consentir à la mener à terme plutôt qu’à l’interrompre, écrit-elle, pas plus qu’assumer le risque du cancer du poumon en fumant ne signifie consentir à une chirurgie plutôt qu’à des soins palliatifs » (Little, 1999). Dans bien d’autres domaines de la vie, nous reconnaissons que les individus peuvent reconsidérer leurs choix une fois que le risque se concrétise. Consentir au risque n’est donc pas consentir à un résultat déterminé. Ainsi, avoir des rapports sexuels, même non protégés, peut signifier accepter la possibilité d’une grossesse, sans que cela entraîne l’obligation de poursuivre celle-ci. Dans un monde où l’échec contraceptif et l’agression sexuelle sont des réalités, une telle exigence paraît à la fois irréaliste et injuste. Comme l’explique William Simulket (2015), si l’on affirmait que le simple fait de ne pas prévenir radicalement tout risque implique un consentement, alors, sachant que le viol est toujours une possibilité, les femmes qui ne subiraient pas d’hystérectomie devraient être considérées comme ayant consenti à tomber enceintes d’un viol.
Ainsi, bien que très convaincante au premier abord, l’analogie du violoniste de Thomson présente tout de même des limites. Elle réduit la grossesse à une relation abstraite et clinique entre deux individus adultes, séparés, en occultant sa dimension profondément incarnée, relationnelle et genrée. Elle dépeint la femme enceinte comme un simple réceptacle, un incubateur fournissant espace et nutriments. Pour défendre le droit à l'avortement, je trouve l'argumentation de Maggie Little plus sensible : dans Abortion, Intimacy, and the Duty to Gestate (1999), celle-ci avance que la grossesse implique une intimité telle qu’elle ne devrait jamais être imposée. Elle écrit : « De la même manière que le rapport sexuel peut être une joie dans le consentement et une violation en son absence, la gestation peut être une expérience magnifique lorsqu’elle est choisie et une expérience terrible lorsqu’elle est imposée. » Little souligne qu’argumenter ainsi ne revient pas à dévaloriser la grossesse : de même que nous n’amoindrissons pas la valeur du sexe consenti en dénonçant le viol, nous ne rabaissons pas la valeur de la maternité désirée en dénonçant la gestation forcée. Le point central, insiste Little, est que le consentement détermine la valeur morale des expériences touchant à l’intégrité physique. Comme le rappelle Eileen McDonagh, un voyage dans un pays merveilleux devient un enlèvement lorsqu'il est imposé ; une chirurgie devient une agression lorsqu'il n'y a pas de consentement. La grossesse, en raison des attentes sociales autour de la maternité, est un terrain particulièrement chargé : les femmes sont censées vouloir ce type d’intrication. Mais quelles que soient les attentes, ce qui importe réellement, c’est ce que la femme désire cet état et y consente.