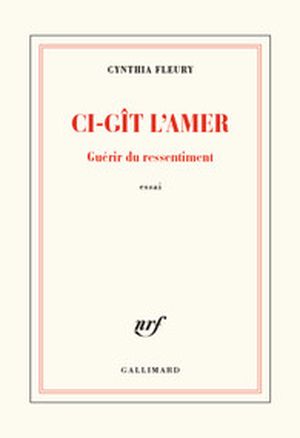L’objectif de cet essai est dans le sous-titre : « Guérir du ressentiment ».
Logiquement on a donc une première partie sur l’amer en commençant par la rumination. « Le terme clé pour comprendre la dynamique du ressentiment est la rumination, quelque chose qui se mâche et se remâche, avec d’ailleurs cette amertume caractéristique d’un aliment fatigué par la mastication. » Ressentiment de l’avoir (l’envie), ressentiment de l’être (jalousie), myriade d’auteurs sont cités à la rescousse : Nietzsche évidemment, Deleuze, Freud, Hegel, Castoriadis, et j’en passe. Mais, bizarrement jamais Spinoza, lui qui a pourtant parlé de l’aliénation des passions tristes, lesquelles correspondent tout à fait aux contours du ressentiment selon Cynthia Fleury. En tout cas pour aborder cette première partie (pour les autres aussi…) le lecteur a intérêt d’être armé de solides références en matière de philosophie, en matière de psychanalyse (surtout) et de se préparer à lire et relire afin de pouvoir digérer l’ensemble des raisonnements tenus.
La deuxième partie traite du ressentiment collectif. On parle ici du fascisme. Cynthia Fleury s’appuie sur deux auteurs : Theodor Adorno (que je n’ai pas lu) et Wilhelm Reich (« Psychologie de masse du fascisme » que j’ai lu il y a bien longtemps). On y retrouve ici l’explication bien connu de la liaison entre haine de soi et haine de l’autre et celle de la frustration notamment sexuelle. Si j’ai bien compris (je suis loin d’en être sûr…), le fascisme prend racine et se développe à partir d’une masse d’individus qui n’aurait pas fait « le deuil d’une demande puérile de protection » (Ci-gît la Mère) n’ayant pas su pas quitter un univers sécurisant et cherchant à le retrouver auprès du chef. En somme, retour aux sources : « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux » (Étienne de la Boétie).
Troisième partie : « La mer »… La question est posée d’entrée : « L’antidote au ressentiment, quel est-il ? » La mer, l’infini, l’universel. Dans ce chapitre, principalement sous les bons auspices de Frantz Fanon (auteur que je ne connais pas, un de plus…), on retrouve les quelques antidotes au ressentiment qui ont déjà été évoqués auparavant : la sublimation, la mise à distance, l’oubli, l’écriture, l’étonnement la cure analytique (Cynthia Fleury n’oublie pas sa boutique…) et le ressentiment lui-même (là je laisse les futurs lecteurs s’en dépatouiller. [Le ressentiment serait un rempart contre la déprime ?]). A chaque fois on se dit : plus facile à écrire qu’à faire. L’auteur en convient par moments.
Si Cynthia Fleury pouvait aussi se forcer à baisser sa hauteur de vue (quoi ? j’suis universitaire merde…) et se donner la peine de redescendre quelque peu pour utiliser un langage plus commun elle en serait remerciée. Mais évidemment cela demande quelques efforts de vulgarisation (si maintenant il faut éduquer la canaille où va-t-on ?), efforts qu’elle fait parfois dans des journaux ou/et magazines comme « Philosophie Magazine ».
Donc je me répète : livre pour lecteurs très motivés et avertis.