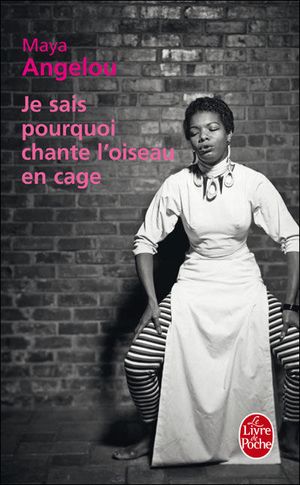Il m’a fallu du temps pour me mettre à lire cette œuvre majeure de la littérature américaine, mais voilà, c’est fait... Et, comme souvent quand on découvre un classique sur le tard, il résonne sans doute davantage parce qu’il touche à plus de cordes.
Je n’ai rien à ajouter à ce qui a été si bien dit tant de fois sur cette œuvre, sinon mon saisissement devant la vivacité du style, qui permet de dire l’horreur d’une expérience personnelle et collective sans rien édulcorer, mais avec un esprit et un humour qui établissent une distance salutaire, parce qu’émancipatrice. C’est la distance de la narratrice, bien sûr, mais l’on se plait à penser – sans doute parce que le récit donne à le penser – que c’était aussi celle de l’enfant dont est racontée la vie.
Cela n’est pas le moindre ressort de l’illusion (auto)biographique qui transforme une série d’expériences en destin cohérent, avec le risque d’expliquer par le caractère individuel la capacité à s’en sortir ; cela transparait mainte fois dans l’œuvre mais exemplairement à la fin, dans un échange avec la mère, qui se termine par cette sentence : « Il n’y avait rien qu’un individu ne pût faire. » C’est le travers où tombe – et là sans beaucoup de distance – un récit à la facture très classique, pour ne pas dire conventionnel.
Mais cette réserve formelle (avec ses conséquences idéologiques) n’enlève rien à la nécessité de ce livre, qui dit le combat qu’ont dû et que doivent encore mener les personnes racisées pour ne pas se perdre dans la domination qui leur est imposée, pour faire valoir leur dignité imprescriptible, en dépit du regard de ceux qui les racisent pour les dominer.