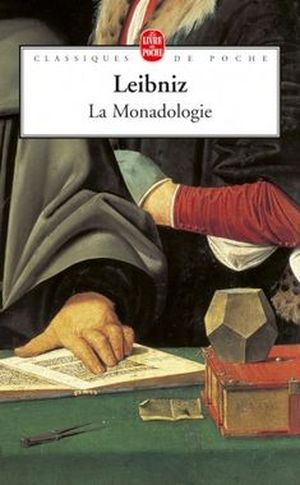Lorsque Leibniz compose "La Monadologie" en 1714, il se borne à un bref résumé de sa philosophie, ainsi que le lui avait demandé le prince Eugène de Savoie. Comme la moitié de son œuvre incommensurable (notre pauvre condition mortelle exclut que nous puissions un jour nous targuer de l’avoir toute lu), ce court ouvrage d’environ 20 pages a de plus été entièrement écrit en français, quoiqu’il ne fût d’abord publié qu’en allemand (Leibniz vécut quatre années à Paris où il côtoya aussi bien Huygens que Malebranche et en profita pour corriger Descartes et montrer la loi de conservation de la force). Notons toutefois, avant de commencer, que malgré les apparences, il est de bon ton de tempérer son enthousiasme au moment d’attaquer sa lecture et de ne pas se laisser prendre par sa faible longueur : sa concision n’a en effet d’égal que la puissance et la richesse de son propos. Le style serré du texte et la densité de sa pensée pourraient effectivement en surprendre, voire en rebuter, plus d’un et même étouffer dans l’œuf les plus audacieuses prétentions. Mais pour peu que l’on s’en tienne à ces quelques conseils, aucune embûche ne devrait se dresser sur le chemin de sa compréhension.
Les similitudes entre la structure de "La Monadologie" et celle du système philosophique qu’elle déploie n’a rien de saugrenu et ne doit rien au hasard. Il s’agit plutôt, à la manière des "Méditations Métaphysiques" de Descartes, d’une mise en abîme du raisonnement leibnizien dans l’exercice de la lecture : la pensée du lecteur accompagne ainsi celle du texte et accède par là même à celle de l’auteur. Mais là encore, la simplicité apparente du propos n’est qu’un écran de fumé à la saisie du système lui-même. Aussi, lorsque l’on constate que Leibniz se répète à l’infini est-on tenté de croire qu’il dit systématiquement la même chose. Ce serait trahir là l’intelligence de l’auteur et ne pas apprécier les multiples couches de son texte. Car comme sa philosophie s’applique à renvoyer chaque partie à l’universel, et réciproquement, dans un mouvement sans cesse renouvelé, son texte embrasse les mêmes ambitions : la philosophie leibnizienne impose alors son systématisme et sa structure au texte et le rapport de la monade au monde est le même que celui du mot à l’idée. En démultipliant et en articulant à l’envie ses différents niveaux de lectures, Leibniz confère ainsi la structure monadologique de sa Métaphysique à sa littérature.
Enfin, la dernière mise en garde concerne son propos même. S’il est dit plus haut que Leibniz conçut "La Monadologie" comme un bref résumé de sa philosophie, il ne faut pas en déduire pour autant qu’elle constitue une porte d’entrée à la philosophie leibnizienne. S’il fallait user de la métaphore, on dirait plutôt qu’elle en est la porte de sortie. Le prince Eugène de Savoie reçut en effet sa copie au cours de l’année 1714, soit deux ans avant la mort du père du calcul infinitésimal. Aussi n’est-il pas étonnant d’y retrouver, si succinct soit le texte, toute la richesse et la profondeur de sa pensée. A cet égard, la lecture du "Discours de métaphysique" (1886) et de sa "Correspondances avec Arnauld" d’une part, puis celle du "Système nouveau de la nature et de la communication des substances" (1695), de "De la production originelle des choses prise à sa racine" (1697), de l’"Essai de dynamique" (1691) et de "De la nature en elle-même" (1698) d’autre part, n’est pas dénuée d’intérêt, voire même chaudement recommandée. Cependant, quoiqu’il fasse directement allusion au concept, l’occurrence de monade n’y est jamais employée par Leibniz. Il faudra pour cela attendre la "Théodicée" (1710), "La Monadologie" elle-même (1714), et les "Principes de la Nature et de la Grâce" (1715).
La Monade, atome de la nature
Leibniz n’a fait qu’emprunter aux néoplatoniciens de Cambridge, réunis autour de Henry More, et en particulier à Anne Conway, le vocable « monade ». Issue du grec monas, signifiant unité, la monade est pour le natif de Leipzig, une substance simple, donc sans étendue ni figure, dont tous les corps composés sont des amas (aggregatum). Dépourvue d’étendue et de figure, la monade ne saurait être, nous en conviendrons aisément, pénétrée du dehors par aucune substance ni aucun accident. Dépourvue de divisibilité, elle ne saurait non plus commencer que par action (fulguration) et finir que par annihilation. Enfin, bien que sans parties par définition, deux « qualités » lui sont néanmoins assignées du point de vue interne : la perception, ou représentation du multiple dans l’unique, d’une part, et l’appétition, ou appétit, ou tendance à passer d’une perception à une autre, d’autre part. L’influence de l’atomisme antique, et d’Epicure en particulier, est ici évidente, quoiqu’elle s’opère à travers la philosophie de Gassendi. Le concédant lui-même volontiers, Leibnitz ira même jusqu’à baptiser sa monade d’Atome de la Nature et d’Eléments des choses. Plus précisément, cette influence s’exerce à deux niveaux dans le concept monadologique de Leibniz. En tant qu’élément simple et indivisible, elle renvoie d’abord directement à l’atome de Démocrite, à la réserve que physique et matérielle chez le philosophe présocratique, elle est d’essence substantielle ou spirituelle chez notre rationaliste. En tant qu’élément capable de changer de perception, elle n’est pas non plus sans rappeler le clinamen épicurien faisant spontanément dévier la chute verticale des atomes dans le vide (le non-être) de manière insensiblement oblique pour bâtir les corps macroscopiques.
Leibniz identifie ensuite trois différents types de monades selon le degré de distinction de leur perception. L’Entéléchie, qui est la monade la plus simple (« toute nue »), n’est douée que de la perception et de l’appétition, en conséquence de quoi les corps qui en sont composés, c’est-à-dire les plantes, manquant de distinction dans leur perception, expérimentent un état d’étourdissement permanant. L’Âme, qui est une Entéléchie enrichie de la mémoire, fournit quant à elle aux corps qu’elle compose, c’est-à-dire les animaux, et par le recours de leurs organes des sens, une consécution empirique qu’il faut prendre bien soin de distinguer de la raison, mais qui leur offre néanmoins des perceptions relevées, c’est-à-dire plus distinctes. L’Esprit, enfin, qui est l’Âme pourvue de la Raison et de l’Aperception, confère aux hommes ainsi faits d’elle, la connaissance des vérités éternelles et la conscience (à savoir l’acte réflexif qui les font se révéler à eux-mêmes en même temps qu’à Dieu) respectivement. Et c’est par la seconde que la première trouve les objets de son opération (le raisonnement), laquelle est fondée d’une part sur le principe de contradiction, qui nous permet de juger du faux et du vrai (par contradiction au faux) et ainsi de dégager des vérités de raisonnement, c’est-à-dire nécessaire absolument, et d’autre part sur le principe de la raison suffisante, en vertu duquel aucun fait ne saurait être vrai sans qu’y soit adossée une raison suffisante pour qu’il en soit ainsi, permettant par là même de dégager des vérités de faits, c’est-à-dire contingentes.
Dieu, la substance simple originaire
Pour autant, la raison suffisante se doit de rendre compte également des vérités contingentes, c’est-à-dire de la suite des choses répandues par l’univers des créatures dont la résolution en raisons particulières pourrait aller à un détail sans bornes. Or, cette raison suffisante ne saurait se trouver à l’issue de cette régression à l’infini du raisonnement, quand bien même il y en aurait une. Aussi se doit-on de la chercher dans Dieu, qui, toujours en vertu de la raison suffisante, ne saurait par ailleurs être multiple, mais unique, un seul Dieu suffisant (là où il y a un être, il y a un être). Par ce raisonnement, Leibniz atteste de la nécessité d’un être tout puissant et démontre ainsi, a posteriori, l’existence de Dieu. Mais le philosophe allemand ne s’arrête pas là dans sa démonstration et en est quitte pour une seconde. En effet, il faut bien, pour qu’il y ait de la réalité dans l’existence et dans l’essence des vérités, qu’il y ait aussi quelque chose d’existant et d’actuel pour le garantir : il faut donc bien qu’il existe un Dieu. Et c’est ainsi que Leibniz démontre l’existence de Dieu a priori, démonstration par ailleurs soutenue par le simple fait qu’il lui suffit d’être possible, pour être actuel, son essence renfermant tous les possibles dont son existence. Ce dernier argument, thomiste en ce qu’il postule l’existence de Dieu dans son essence, et cartésien en ce qu’il affirme la prédication de son existence dans son infinie perfection, Kant le rapprochera de l’argument ontologique de Descartes. Dieu démontré, encore reste-t-il à Leibniz de définir son essence. Tout à la fois unique, parfaite, illimitée, universelle et nécessaire, l’essence ou la substance divine possède en outre la Puissance, source de tout, la Connaissance, lieu du détail des idées, et la Volonté, patronne des changements, la première fondant le sujet de la monade (créée par fulguration continuelle), la seconde, la perception, et la troisième, l’appétition. Enfin, si les vérités contingentes, arbitraires, sont le fait de la « convenance » de sa Volonté, les vérités de raisonnement, autrement appelées vérités éternelles, sont quant à elles le fruit de son entendement.
Le monde créé leibnizien
Parmi les vérités contingentes qui peuplent les Idées de Dieu, il y a une infinité d’univers possibles. Aussi, eu-ce égard à leur degré de perfection respectif et conformément à sa volonté et à son principe de « convenance » qu’il choisit de créer le meilleur, c’est-à-dire celui consistant dans le plus de variétés possibles, avec le plus grand ordre. Arrêtons-nous ici un moment pour assiéger la place du Rationalisme et resituer la pensée de ses plus illustres représentants par rapport à celle de Leibniz. A l’inverse de Descartes, qui établissait une correspondance causale entre les substances (la chose pensante, c’est-à-dire le cogito, et le corps, c’est-à-dire le monde extérieur), ce dernier niait toute causalité inter-substantielle, lui préférant une harmonie préétablie sous la forme d’un parallélisme substantielle. Si comme Malebranche, le sage auquel Spinoza refusa d’envoyer son "Ethique" plaçait Dieu et uniquement Dieu derrière la survenue de toute chose survenant, il s’opposait en revanche à son occasionnalisme, qui supposait le renouvellement permanent de sa création, et soutenait, à la place, son caractère préétabli depuis sa conception : tout ce qui se passe depuis lors n’est ainsi, pour lui, que la réalisation de ce qui était déjà là. En cela, sinon Spinoza, nul n’a été plus minimaliste, plus déterministe, et serait-on même tenté de dire, plus nihiliste, que Leibniz dans toute la tradition rationaliste.
Reprenons maintenant la description de l’univers leibnitzien. Il n’en existe qu’un, Dieu l’a choisi parmi l’infinité des possibles, et il n’aurait pu être plus parfait. Sa réalité est en outre contenue dans les monades qui le composent, c’est-à-dire dans les Vies, les Âmes et les Esprit qu’il abrite. Or, comme nous l’avons vu plus haut, étant dépourvues d’étendue, et donc de pénétrabilité, ces dernières ne sauraient logiquement ni affecter, ni être affectées en retour, par autre chose qu’elle-même, si bien que la seule forme de commerce qu’elles entretiennent avec leurs sœurs relève d’une harmonie préétablie par Dieu qui s’accomplit au travers de leurs perceptions. Par cette faculté de se représenter le multiple dans l’unique, c’est-à-dire toutes les autres monades en elle-même, chaque monade établit des rapports qui les expriment toutes, et respectivement (c’est-à-dire qu’à chaque perception distincte de l’une correspondent, en toutes les autres, des perceptions confuses) et se comporte ainsi à la manière d’un « miroir vivant perpétuel de l’univers », à son point de vue. L’univers leibnizien se présente donc à chaque monade comme un puzzle décomposé dont la multitude infinie des pièces seraient autant de perspectives subjectives, distinctes dans le particulier (depuis leur « point de vue ») et confuses dans la totalité, d’autant de monades et dont la réunion offrirait le tableau complet que seul Dieu connait. En vertu de sa représentativité de l’univers, c’est-à-dire de sa capacité à se représenter la coexistence de l’infinité des autres monades, le concept de monade permet ainsi à Leibniz de déduire l’ordre spatio-temporel de l’univers. Autrement dit, l’univers n’est que la conséquence phénoménale de l’activité perceptuelle des monades, préétablie par Dieu au moment de la création. En ceci, on peut dire que Leibnitz est un « idéaliste phénoménaliste ».
L’union de l’âme et du corps
Le parallélisme psycho-physiologique de Leibniz, qui explique les modalités d’union de l’âme et du corps, suit et prolonge le concept de l’harmonie préétablie. Comme nous venons de le voir, c’est par le ressort de leurs perceptions, pré-ordinées par Dieu, que chaque monade influe sur les autres et rend compte de l’univers. Les corps, en cela, imitent cette influence réciproque, quoique sur un mode moins idéal, par le recours de la mécanique. Tout étant plein, et donc lié, aucun mouvement en un point de l’univers ne saurait en effet se répercuter de proche en proche sans qu’il s’en ressente en un autre point. Aussi peut-on dire qu’à l’image de la monade, tout corps est affecté par les corps, et réciproquement, de telle manière qu’à tout changement dans un corps correspondent des changements contraires dans les autres, et que tout corps exprime par conséquent tout l’univers par la connexion de toute la matière dans le plein qui le compose. On retrouve donc le même ordre chez les corps que chez les monades et, bien que les lois qui les régissent soient différentes (lois des causes finales pour les monades et lois des causes efficientes pour les corps), elles leur permettent de se rencontrer en vertu de l’harmonie préétablie, corps et monades étant des représentations d’un même univers. Ainsi, on dira qu’un corps est agir lorsque sa monade aura l’action (c’est-à-dire des perceptions distinctes) et pâtir lorsqu’elle aura la passion (c’est-à-dire des perceptions confuses), ce qui se trouve dans le premier corps (la monade active) permettant de rendre raison de ce qui se passe dans le second (la monade passive). C’est de cette manière que les corps ont des actions et des passions mutuelles entre eux et que chacun rend compte des autres. Quoiqu’on pense de la philosophie de Descartes et de celle Leibniz, et où qu’aille notre préférence, on ne peut qu’être subjugué par la tenue et la poésie de la seconde (bien que séduisant par sa radicalité, le dualisme cartésien est, il faut l’avouer, pétri de d’approximations et d’imperfections).
L’ordre du monde
Ainsi, quoique chaque monade représente tout l’univers par l’influence de ses perceptions (causes finales) et que chaque corps en fait tout autant par l’influence de ses mouvements (causes efficientes), chaque monade représente plus distinctement le corps qui lui est rattaché. L’Entéléchie fera ainsi les vivants, l’Âme les animaux et l’Esprit les hommes, comme nous l’avons déjà vu. Mais l’art divin, c’est-à-dire la Nature (on note ici l’opposition entre le transcendantalisme de Leibnitz et l’immanentisme de Spinoza selon lequel « Deus sive natura »), est à ce point parfait qu’il a encore subdivisé à l’infini chaque partie de la matière en d’autres parties et gratifié chacune d’une monade, si bien qu’on trouve dans chaque corps doté d’une monade dominante, d’autres corps dotés d’autres monades dominantes et ainsi de suite, comme on trouverait dans un poisson nageant dans un étang d’eau, d’autres étangs d’eau avec d’autres poissons nageant en son sein à l’infini. Pour autant aucune de ces monades n’est spécifiquement assignée à aucun de ces corps, ceux-ci, tel les cours d’eau qui se jettent dans l’étang, étant dans un flux permanent. Ainsi, les monades changent graduellement mais incessamment de corps par métamorphose plus que par métempsychose : c’est pour cette raison que Leibnitz ne reconnait « ni génération entière, ni mort parfaite », mais « des développements et des accroissements » et « des enveloppements et des diminutions », respectivement. Autrement, dit, en tant que miroir d’un univers indestructible, les monades le sont tout autant, tout comme les corps à travers elles et auxquels elles donnent la Vie, l’Animal où l’Homme, quoique la machine organique périsse ou guérisse par parties. Dit encore autrement, c’est l’immortalité que propose Leibniz.
Selon le degré de perfections des monades qui les font, Leibniz distingue ensuite trois différents types de créatures et donc, trois différents types de mondes, qu’on peut également hiérarchiser selon leur degré de perfection. Le monde premier, le plus simple, est celui des vivants. Divisible à l’infini, il est formé par les Entéléchies et les vivants qu’elles peuplent. Directement superposé, lui succède le monde des animaux, « miroir de l’univers des créatures », où opèrent Âmes et animaux. Enfin, le monde le plus éthéré, celui des Esprits, est donné aux hommes, pourvus de telles monades. Parce qu’il est le plus perfectionné dans la création, et en vertu de l’harmonie préétablie, il agit comme un « miroir de la Divinité même » et peut prétendre, par là même, entrer dans une quelconque forme de société avec elle. Fédérés, tous les Esprit composent ainsi la « Cité de Dieu », c’est-à-dire « le plus parfait état qui soit possible sous le plus parfait des monarques ».
La Théodicée : l’optimisme et le providentialisme de Leibniz
Des trois mondes superposés que nous venons de voir, et des deux régimes de lois gouvernant l’univers, vus encore auparavant (causes finales et causes efficientes), Leibniz tire une dernière ordination harmonique et préétablie, et distingue entre le règne physique de la Nature et le règne moral de la Grâce, c’est-à-dire entre Dieu Architecte de la machine de l’univers et Dieu Monarque et Législateur de la Cite divine des Esprits. Plus précisément, s’il y a bien distinction, c’est plutôt à une hiérarchisation que le bibliothécaire du Brunswick-Lunebourg se livre ici. Aussi subordonne-t-il l’Architecte au Monarque, la physique à la morale et la Nature à la Grâce : l’accession à la Grâce n’emprunte plus alors que les chemins de la Nature et Esprits vertueux comme pécheurs reçoivent désormais des voies machinales de la physique leurs justes récompenses et peines méritées. Les principes de la "Théodicée", c’est-à-dire de la justice divine, et de l’optimisme de Leibniz se débrouillent ainsi à l’issue de la présentation de sa métaphysique. Néanmoins, sa position quant au statut du Mal dans son système philosophique n’est pas clairement établie. En effet, s’il s’est jusqu’ici attaché à dépeindre la perfection de l’univers créé par Dieu, aucune mention n’y est jamais faite de la place accordée à l’existence du mal. Et pourtant, à y regarder de plus près, la réponse semble évidente tant elle transparaît en filigrane tout au long du texte. En effet, on sait que Dieu a choisi de créé l’univers parmi l’infinité des possibles qui s’offrait à lui, et qu’il n’aurait pu avoir choisi avec plus de convenance, et qu’ainsi, il ne saurait y avoir de monde plus parfait. L’emploi du comparatif « plus » en dit ici plus long qu’il n’y parait. Il ne s’agit plus en effet pour Leibniz de décrire la perfection absolue de Dieu mais d’exposer la relative et approximative perfection de sa création. Aussi parfaite soit-elle, elle ne saurait logiquement sortir vainqueur d’une comparaison avec Dieu. Aussi, rien n’étant aussi parfait que Dieu, et Dieu étant infiniment bon, sa création ne pourrait l’être tout autant : et c’est ainsi que Leibniz justifie l’existence du Mal sur Terre, n’en déplaise aux panglosseries de Voltaire. Le Mal est donc pour Leibniz, une condition sine qua non de l’existence du monde, une conséquence inséparable de l’acte de création.