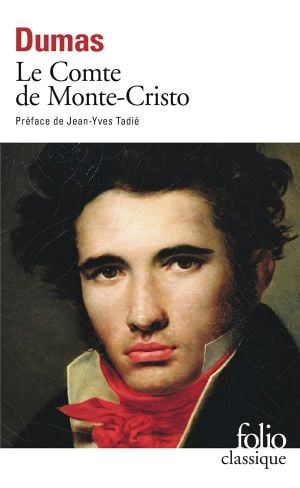Lecture d'été, étant donnée l'ampleur de l'oeuvre. N'ayant vu aucune des adaptations cinématographiques, c'est par le roman de Dumas que je découvre l'histoire. Celle d'Edmond Dantès, à qui tout souriait, la perspective d'une brillante carrière ainsi qu'une adorable créature à épouser, et qui se voit jeté en prison au château d'If en raison d'une cabale. Trois hommes à la manœuvre : Fernand Mondego, qui peut ainsi récupérer la belle Mercédès qu'il convoitait en vain, et se faire renommer Comte de Morcerf ; Danglars, qui hérite du poste promis à Dantès et devient banquier richissime pendant que son rival moisit en prison ; et Villefort, qui sauve sa peau de procureur du roi en faisant condamner un innocent. On ajoutera à ces trois vilains un semi-méchant, Caderousse, en témoin passif du complot. Tous quatre seront punis : Caderousse sera assassiné par son comparse Benedetto lors d'un cambriolage, Fernand sera poussé au suicide, déshonoré par la révélation d'une trahison, Villefort perdra sa femme et son plus jeune fils dans une sombre histoire d'empoisonnement, Danglars, enfin, sera ruiné et mis au ban de la société. Nul acte vengeur de la part de Dantès : sa revanche est indirecte. Tel le Dieu courroucé de l'Ancien testament, il tire les ficelles pour châtier les coupables tout en sauvant les purs - ici, le fils de l'armateur Morrel et sa fiancée Valentine, Albert de Morcerf.
Pour tenir 1 400 pages sur cet argument, il fallait emprunter de nombreux détours et multiplier les personnages. On croisera donc l'abbé Farsi, le savant homme d'église rencontré au bagne dont la mort permettra à Dantès de s'échapper, après qu'il lui aura indiqué l'emplacement d'un fabuleux trésor. Albert de Morcerf, fils de Fernand et Mercédès, qui provoquera Dantès en duel avant de découvrir le pot aux roses et finalement rendre justice au Comte. Son ami Franz d'Epinay, qu'on suit dans une (bien longue) épopée à Rome avec Albert, avant qu'on les retrouve tous deux à Paris, le premier promis à la fille de Villefort (Valentine), le second à la fille de Danglars (Eugénie). D'autres proches d'Albert, dont Beauchamp le journaliste et Debray le politique. Les épouses de Villefort et de Danglars, pas piquées des vers, la première cherchant à empoisonner sa bru et ses parents pour récupérer l'héritage au profit de son fils Edouard, la seconde amante de Debray uniquement préoccupée de sa fortune. Noirtier, le père de Villefort, bonapartiste devenu paralysé qui tente à coup de regards signifiants de protéger sa chère petite fille Valentine. Haydée, une ancienne noble achetée comme esclave par le Comte de MC, qui permettra de faire tomber Mondego. Benedetto, un bagnard recruté par Dantès pour jouer le rôle d'Andrea Cavalcanti, faux comte italien destiné à faire chuter à la fois Danglars et Villefort. Ali, fidèle serviteur noir du Comte de MC. Luigi Vampa, un fameux brigand que Dantès se mettra aussi dans la poche. Et bien d'autres. Quant au Comte de MC, il se dissimule tour à tour sous les traits de Lord Wilmore, d'un certain Zaccone ou de l'abbé Busoni, quand il ne se fait pas appeler tout simplement Simbad le marin.
Comme tout ce petit monde se croise en circuit fermé, on apprendra que la femme de Danglars fut la maîtresse de Villefort, d'où naquit un enfant que le couple tenta d'ensevelir dans la terre : cet enfant ne sera autre que Benedetto. Que Noirtier fut le meurtrier du père de Franz, ce qui annulera toute possibilité de mariage avec sa petite-fille Valentine. Que Monte-Cristo sauva de la misère à la fois la famille Morrel et le couple Caderousse, le second ne lui en étant nullement reconnaissant puisqu'il tentera de le cambrioler. Dumas ose même une histoire de lesbianisme, audacieuse pour l'époque, avec la fuite d'Eugénie Danglars déguisée en garçon aux bras de son amie Louise d'Armilly.
C'est foisonnant, parfois un peu trop, mais comme c'est intelligemment agencé et surtout essentiellement narré sous forme de dialogues, ça se lit bien : un gros mois pour ma part.
Bien sûr, le récit fourmille d'invraisemblances. Les tunnels creusés avec une petite cuillère pour que Dantès et Farsi communiquent. L'instruction phénoménale de Dantès par Farsi. Le fait que personne ne reconnaisse jamais le Comte de MC derrière ses déguisements (sauf bien sûr Mercédès : l'amououououour). Noirtier qui parvient toujours à se faire comprendre avec des œillades. Les empoisonnements successifs chez les Villefort et la "résurrection" de Valentine. Toutes les coïncidences qui font que les personnages se retrouvent dans les mêmes lieux (exemple : Benedetto en fuite s'arrête au même hôtel qu'Eugénie et Louise). Etc.
La langue ? On n'est ni chez Balzac ni chez Proust, mais bon nombre de délices littéraires agrémentent la lecture. En voici moult exemples.
La prose de Dumas ne manque pas d'humour. Dès la page 36, l'armateur Morrel s'inquiète du sort de son bateau, surtout pour son chargement. Dantès le rassure :
- Il est arrivé à bon port, monsieur Morrel, et je crois que vous serez content sous de rapport ; mais ce pauvre capitaine Leclère...
- Qui lui est-il don arrivé ? demanda l'armateur d'un air visiblement soulagé ; que lui est-il donc arrivé à ce brave capitaine ?
Savoureux. A plusieurs reprises, Dumas utilise l'idée assez réjouissante que ce qui se passe ne peut être traduit par les mots. Page 405 : "- Eh ! que voulez-vous, Excellence ! dit-il avec un sourire impossible à décrire, on faut un peu de tout ; il faut bien vivre." Page 440 : "Pendant qu'Albert déduisait cette proposition, maître Pastrini faisait une figure qu'on essayerait vainement de décrire". Page 530 : "Ce mot fut prononcé avec une intonation impossible à rendre".
On relève quelques belles périphrases. Ainsi, parmi beaucoup d'autres, page 78 : "(...) enfin tous ces hors-d’œuvre délicats que la vague roule sur sa rive sablonneuse, et que les pêcheurs reconnaissants désignent sous le nom de fruits de mer". Proustien.
Des tournures subtiles. Page 82 : "on eût dit que la catastrophe venait de tirer le voile que l'ivresse de la veille avait jeté entre lui et sa mémoire". Page 164 :
M. Morrel s'attendait à trouver Villefort abattu : il le trouva comme il l'avait vu six semaines auparavant, c'est-à-dire calme, ferme et plein de cette froide politesse, la plus infranchissable de toutes les barrières qui séparent l'homme élevé de l'homme vulgaire.
Deux pages plus loin, alors qu'on évoque devant Villefort le nom d'Edmond Dantès :
Evidemment, Villefort eût autant aimé, dans un duel, essuyer le feu de son adversaire à vingt-cinq pas, que d'entendre prononcer ainsi ce nom à bout portant ; cependant il ne sourcilla point.
Page 332 : "Et il referma l'écrin, et remit dans sa poche le diamant qui continuait d'étinceler au fond de la pensée de Caderousse". Page 642 : "Quoique je n'eusse pas vu le visage de Villefort, je le reconnus au battement de mon cœur".
Page 738, Maximilien s'adressant à sa Valentine chérie : "(...) toutes les fois que je vous vois, j'ai besoin de vous dire que je vous adore, afin que l'écho de mes propres parole me caresse doucement le cœur lorsque je ne vous vois plus."
Page 1003, alors que Benedetto-Cavalcanti converse avec Danglars, qu'il convainc de lui donner sa fille Eugénie :
- Eh bien ! à merveille, beau-père", dit Cavalcanti, se laissant entraîner à la nature quelque peu vulgaire qui, de temps en temps, malgré ses efforts, faisait éclater le vernis aristocratique dont il essayait de les couvrir.
Page 1160, deux belles tournures se succèdent. S'agissant de Danglars face à sa fille :
Sous le regard interrogateur de sa fille, en face de ce beau sourcil noir, froncé par l'interrogation, il se retourna avec prudence et se calma aussitôt, dompté par la main de fer de la circonspection.
Eugénie regarda Danglars, fort surprise qu'on lui contestât l'un des fleurons de la couronne d'orgueil qu'elle venait de poser si superbement sur sa tête.
Page 1278, alors que Mercédès s'apprête à fuir avec son fils :
... s'apercevant qu'à toute minute Albert la regardait à la dérobée pour juger de l'état de son cœur, elle s'était astreinte à un monotone sourire des lèvres qui, en l'absence de ce feu si doux du sourire des yeux, fait l'effet d'une simple réverbération de lumière, c'est-à-dire d'une clarté sans chaleur.
Des métaphores bien senties. Page 161 : "Les soldats, que vous croyez mourants de faim, écrasés de fatigue, prêts à déserter, s'augmentent comme les atomes de neige autour de la boule qui se précipite." Page 660, s'agissant de Benedetto :
Et il tira de sa poche une paire de petits pistolets chargés jusqu'à la gueule.
- Voilà, dit-il, des chiens qui aboient et mordent en même temps : c'est pour les deux premiers qui auraient envie de votre diamant, père Caderousse.
Page 729, à propos de la relation entre Nortois et Valentine :
A ce langage muet ou inintelligible pour tout autre, elle répondait avec toute sa voix, toute sa physionomie, toute son âme, de sorte qu'il s'établissait des dialogues animés entre cette jeune fille et cette prétendue argile, à peu près redevenue poussière, et qui cependant était encore un homme d'un savoir immense, d'une pénétration inouïe et d'une volonté aussi puissante que peut l'être l'âme enfermée dans une matière par laquelle elle a perdu de pouvoir de se faire obéir.
Joliment tourné, même si l'on note dans cet extrait un travers de Dumas - qu'il partage avec un grand styliste, Stephan Zweig - : l'emphase. Savoir immense, pénétration inouïe, volonté aussi puissante... De même page 1101, lorsque Mercédès se confie à Edmond qu'elle a reconnu :
Edmond, je vous le jure sur la tête de ce fils pour lequel je vous implore, Edmond, pendant dix ans j'ai vu chaque nuit des hommes qui balançaient quelque chose d'informe et d'inconnu au haut d'un rocher ; pendant dix ans j'ai, chaque nuit, entendu un cri terrible qui m'a réveillée frissonnante et glacée.
Chaque nuit pendant dix ans, vraiment ?!...
Certains marqueurs de l'époque sont instructifs : Dumas fait souvent référence à la nature intuitive des femmes ou au caractère simplet des Africains, et l'on apprend qu'il fallait quinze heures pour relier la Normandie à Paris. L'écrivain est un croyant assumé, faisant référence, dans la bouche de MC, à la volonté divine, comme page 1355, où l'on peut lire : "un de ses caprices du sort qui ferait douter de la bonté de Dieu, si Dieu ne se révélait plus tard en montrant que tout est pour lui un moyen de conduire à son unité infinie". Edmond est d'ailleurs convaincu, en accomplissant sa vengeance, d'obéir à la volonté du Très-Haut. La mort du jeune Edouard le fera douter du bienfondé de son action.
Wikipedia nous apprend par ailleurs que le personnage du Comte de MC a quelques similitudes avec le destin de Napoléon III. Louis-Napoléon, en effet, s'échappa de sa geôle sous déguisement avant de rejoindre les Républicains et se faire élire premier président de la République française en 1848. Or le roman est sorti entre 1844 et 1846. Intéressant.
On trouve aussi quelques réflexions philosophiques, telles que celle-ci, page 222 :
Il faut le malheur pour creuser certaines mines mystérieuses cachées dans l'intelligence humaine ; il faut la pression pour faire éclater la poudre.
Page 1067 :
Les hommes vraiment généreux sont toujours prêts à devenir compatissants, lorsque le malheur de leur ennemi dépasse les limites de leur haine.
Deux réserves malgré tout avant de conclure. On déplore quelques répétitions inutiles. Page 535 : "Les fêtes sont pour eux de véritables fêtes". Bof. Page 553 : "Eh bien, dit tranquillement celui-ci d'une voix parfaitement calme et sans qu'un seul muscle de son visage bougeât" - "tranquillement" est de trop ici.
Une poignée de métaphores banales enfin. Page 681 : "Oh ! pas du tout, dit le comte avec une froideur de marbre." Page 739 : "Hélas, Maximilien, dit-elle tristement et comme si un nuage jaloux était soudain venu voiler le rayon de soleil qui illuminait son cœur".
Le peu de places qu'occupent ces réserves dit assez bien la qualité de la prose du grand romancier populaire qu'est Alexandre Dumas. Un cran en dessous de Hugo peut-être ? L'été prochain, ce sera Les Misérables. Prévoir sans doute une très longue critique pour en rendre compte.
7,5