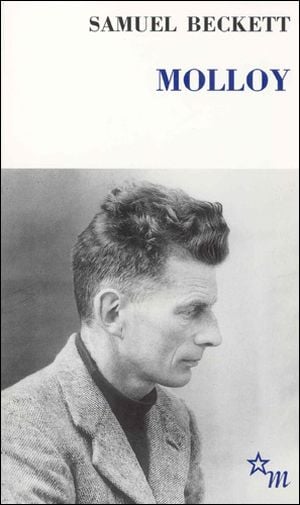Molloy ne sait pas où il habite. Moran ne sait pas où est Molloy. Molloy a une jambe raide, la droite ? La gauche ? Il ne sait pas. Alors évidemment je pourrais vous parler de méta textualité. En voilà un exemple :
« Qu’à cela ne tienne, poursuivons, faisons comme si tout était surgi du même ennui, meublons, meublons, jusqu’au plein noir. »
En effet, Beckett s’adresse au lecteur, dans une mise en abyme de l’acte d’écrire.
Quoi de plus moderne, en substance, que de s’adresser au lecteur, quitte à le taquiner un peu, rien qu’un peu.
« Cette maison, dois-je la décrire ? Je ne crois pas. Je n’en ferai rien. » (les devoirs des écrivains réalistes du XIXᵉ sont pointés du doigt et tournés en dérision.) « Et tout est là, finir, en finir. »
à propos des choses (en littérature) qui ne méritent pas d’être mentionnées, notre cher Samuel Beckett aurait plié Guerre et Paix en 250 pages.
« Et tout d’un coup je me rappelai mon nom, Molloy. Je m’appelle Molloy […]. Molloy, ça me revient à l’instant. Rien ne m’obligeait à fournir ce renseignement, mais je le fournis, espérant sans doute faire plaisir. »
Nous apprenons à la fois le nom du personnage éponyme, la moquerie de Beckett par la même occasion, à l’endroit du lecteur. Il y a de la métatextualité, disais-je, et des métatextes aussi. Proust par exemple : l’auteur de La Recherche met en scène un héros tombant en pamoison devant des aubépines à l’occasion d’un souvenir d’enfance, l’occasion pour Beckett de dire : « La blanche aubépine se penchait vers moi, malheureusement je n’aime pas l’odeur de l’aubépine. » Le narrateur de la première partie de ce roman va même jusqu’à bouffer de la terre, ce qui entérine le décalage voulu avec le métatexte proustien. (n'oublions pas l’ouvrage/essai intitulé Proust écrit par Beckett). D’ailleurs on ne fait que « balbutier sa leçon » selon le narrateur (« dire c’est inventer »), quid de mon analyse. En littérature, la forme revêt une importance primordiale : une œuvre ne saurait se réduire à la transmission d'un message. Ceci étant dit, quelques translations d’expressions canoniques interviennent dans le texte, comme par exemple :
« celle (la ville) qui m’avait donné la nuit […]. »
Le dire est quelque chose de complexe pour Beckett, rien n’est dit de but en blanc, sans prétérition ni repentir, au sens de la grande peinture, le texte achoppe sur chaque phrase, quasiment, sur chaque affirmation sont couvés deux négations, d’où l'utilisation du groupe de mots « et inversement », qui intervient beaucoup dans le texte.
« C'est là une des raisons pour lesquelles j'évite de parler autant que possible. Car je dis toujours, ou trop ou trop peu, ce qui me fait de la peine, tellement je suis épris de vérité. »
Le texte est contenu dans cette ambiguïté, dans cette dualité entre parler et se taire, pour mieux parler encore. En fait Beckett est très bavard malgré ses « abrégeons ». Allez, une petite paronomase page 63 : « Amollir Molloy », on reconnaît ici le jeu sur les sonorités.
Ceci étant dit sur les procédés stylistiques présents ,rajoutons que l'histoire de ce roman est trouble. Peut-être une enquête lorsque Moran recherche le mystérieux et babillard Molloy.
Peut-être pas totalement. Molloy perd sa mère, peut-être une blessure de l’écrivain. En tout cas c’est le pressentiment que j’ai, un peu comme Molloy disant qu’on n'y comprend rien à ce genre de pressentiments, et que c’est souvent les meilleurs car on n’y comprend rien justement.
Moran, est quant à lui, un personnage beaucoup plus dans l’action, il veut inculquer des choses à son fils, notamment à « se priver » : en allemand Sollst entbehren dans le texte.
Le livre possède des scènes mémorables car très fastidieuses pour le lecteur (on pense à la scène des cailloux, si vous l’avez lu vous savez de quoi je parle).
J’ai aimé ce livre, il me semble drôle et en même temps effrayant d’audace, il réinvente sans cesse l’acte d’écriture d’un roman, nous mène en bateau, et à l’instar de Faulkner, Sarraute, Woolf, Joyce nous plonge dans la modernité pour les siècles à venir.