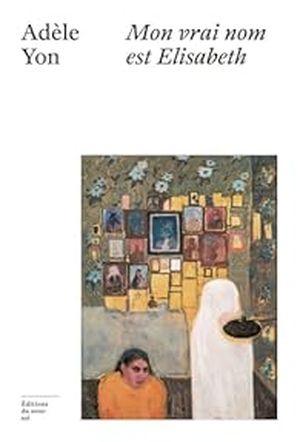« Mon vrai nom est Elizabeth » est un récit bouleversant qui mêle enquête intime et mémoire familiale. J’ai été profondément marquée par la justesse de la narration et la manière dont le livre éclaire le sort des femmes non conformes au siècle dernier. Seul bémol à mes yeux : un épisode clé — l’incendie du château — reste un peu trop dans l’ombre. Et vous, serez-vous tout aussi troublé·e ?
Comment débute le livre ?
Le livre s’ouvre avec le suicide de Jean-Louis, grand-oncle de la narratrice et fils de Betsy, suicide dont la préparation poussée à l’extrême prend de court la famille.
La narratrice connaît la maladie dont a souffert Betsy, elle était schizophrène et a été internée pendant dix-sept ans. Risque-t-elle, un jour, de voir aussi sa santé mentale décliner ? Elle décide alors d’enquêter.
Mon vrai nom est Elizabeth suit l’enquête et comporte des lettres et des archives.
Qu’en ai-je pensé ?
J’ai été remuée par ce récit. En effet, à la fin du livre, j’avais de sérieux doutes sur le diagnostic des médecins (la narratrice ne se prononce pas).
Ce qui est certain, c’est qu’il était dangereux, au milieu du siècle dernier, pour une femme qui n’avait pas un comportement standard d’être née dans une famille patriarcale. Dès le début, le passage d’une lettre d’André, le fiancé de Betsy, m’a fait frémir :
Car le Seigneur a voulu qu’un mari conduise sa femme. Sans doute, vous êtes libre, mais jusqu’à un certain point seulement, car je suis votre chef. La Providence m’a institué tel .
Le ton est donné. Quant au comportement d’André, il ne s’arrange pas ensuite. Et tout à la fin, vous découvrirez une autre conduite masculine douteuse.
Le livre évoque aussi la lobotomie, cette chirurgie qui, au prétexte de soigner, enlevait une partie du cerveau. Avec une découverte — mais est-ce si surprenant — les patientes auraient été en majorité des femmes (des présomptions, mais pas de preuves scientifiques).
La chronique sur dequoilire