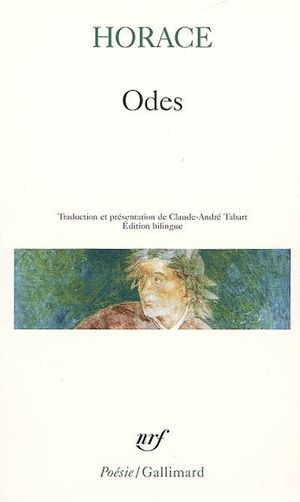Horace est celui qui a réinventé la poésie lyrique telle qu’elle était exercée en Grèce au VIe siècle av. J.-C. Ayant reçu une éducation austère et ferme à l'école, il a continuellement gardé cette empreinte alliant un sens moral très exigeant à une familiarité pointue avec les classiques de la littérature grecque et latine. De plus, à l'image des jeunes Romains de bonne famille, il étudia profondément la philosophie à Athènes. Dès lors, il manifesta, sans dogmatisme ni sectarisme, une passion pour le désir de chercher la vérité. Mais, emporté par la fougue républicaine après l'assassinat de Jules César par Brutus, Horace fut jeté dans l'expérience de la guerre sans être un soldat émérite. À son retour, il fut dépouillé des biens de son père et avait, par conséquent, une mauvaise fortune. C'est à partir de ce moment qu'il se mit à écrire frénétiquement ses fameux vers. Se liant d'amitié avec Virgile et Varius, qui entrevoyaient son talent, il se vit présenter à Mécène, un proche conseiller d'Auguste, très appliqué dans l'art et dans la découverte de nouveaux artistes. Horace dédiera ses odes à son protecteur, dont il affirmera son affection pour celui-ci. Après avoir renouvelé la poésie satirique dans ses Épodes et ses Satires, pendant lesquelles Mécène lui offrit un domaine en Sabine, le poète prit ses distances avec l'épicurisme pour se rapprocher des principes de la doctrine stoïcienne. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'il put se rapprocher d'Octave, devenu Auguste après le triomphe d'Actium en -31. Loin de la foule de Rome, c'est là qu’il commença à composer ses Odes.
Maturé pendant longtemps, Horace adapta son latin à la poésie éolienne du VIe siècle av. J.-C., celle provenant de l’île de Lesbos, en Grèce, où la fameuse poétesse Sappho avait exprimé tout son lyrisme. Il s'opposait au maniérisme de son époque, qu'il désapprouvait, car trop mondaine à son goût, sans pour autant totalement se soustraire à l'influence hellénistique. Par exemple, il ne se rattachait pas à Pindare, sûrement le plus célèbre des poètes grecs, qu'il trouvait trop audacieux dans ses dithyrambes, ses images foisonnantes et ses rythmes s'affranchissant des lois. Horace aimait la poésie musicale et chorale, mais son style était plus proche, bien avant l'heure, de la prose, dépourvue d'organisation rigide. Mais cela ne veut pas dire que ses odes sont chaotiques, bien au contraire. Elles sont à la fois une construction savante et constamment consciente, dans laquelle l'organisation des thèmes est primordiale. Ses vers sont studieux et virtuoses, mais il y impose une patiente rigueur, une régularité concise et une recherche âpre, à l'instar d'une abeille dont le travail est laborieux. De ce fait, il s'oppose à la poésie sublime, naturelle et spontanée de Pindare, dont il admire pourtant le génie naturel et l'élan divin. Mais la poésie d'Horace est celle de l'ordre et de la clarté. Il amène toujours ses vers à dire, sur le moment, ce qui doit être dit. Son style fuit le désordre et l'excès pour aller vers la mesure, la justesse, l'équilibre et la lucidité morale. Il y a malgré tout une forme de solennité, mais souple, car il faut qu'elle soit proportionnée, légère et harmonieuse pour sans cesse capturer l'essentiel et l'essence du thème abordé.
Ainsi, la métrique éolienne, le genre lyrique et la juste mesure de son ton se mêlent parfaitement à la variété des registres dont fait preuve le poète latin. Ce dernier passe aisément de l'ode érotique et bachique aux petits billets qui invitent à la douceur de l'amitié, à la consolation et au bonheur d'une vie simple. Il lie cela aux hymnes qu'il adresse à diverses divinités, notamment Mercure et Bacchus, protecteurs des poètes, et à des pièces d'exhortation morale. En effet, l'auteur médite sur la condition de l'homme pour nous inviter à suivre la voie de l’aurea mediocritas ou la règle du juste milieu, à l'image de cette belle métaphore : « La bonne direction dans la vie, Licinius, c'est de ne pas pousser toujours vers la haute mer, c'est aussi de n'aller point, dans une horreur prudente des tempêtes, serrer de trop près le rivage peu sûr. » L'auteur met également en avant l'idée de la retraite paisible, loin de la foule agitée de la politique, afin de ne plus se laisser déborder par les affaires de celle-ci.
Surtout, ses Odes conseillent de faire preuve de sagesse en attendant la mort, étant donné qu'il faut se résigner à l'inévitable et ne pas vouloir reculer l'échéance ultime, car « nous devrons faire la traversée, que nous soyons rois ou cultivateurs indigents » et nous sommes obligés de « monter dans la barque pour l'éternel exil ». Son fameux « Carpe Diem » (« Cueille le jour, sans te fier le moins du monde au lendemain ») est l'incarnation même de sa poésie, qui prend les proportions d'une philosophie pratique. Horace maintient l'équilibre entre l'épicurisme et le stoïcisme. Il accorde de l'importance au devoir de fêter des moments importants, ceux qui sacralisent la beauté d'une vie éphémère, de ses petits plaisirs ou d'une cérémonie, tout en recommandant de ne pas céder à l'ivresse, à la colère et au chagrin d'amour. Il faut également se limiter dans ses ambitions et se contenter de sa condition dans le but de profiter de son temps libre. Enfin, Horace est sévère avec l'agent féminin, malgré ses poésies amoureuses, parce qu'il accuse souvent celle-ci de ne pas accepter le sort de leur vieillesse ; mais également, il lui reproche de détourner de son intention la jeunesse romaine, qui se doit de rester vertueuse et loyale dans son devoir de citoyen romain.
Il écrit en même temps des odes civiques, particulièrement dans les odes dites romaines du livre III, où il fait l'éloge de Rome et de sa grandeur. Par ailleurs, il constate les effets bénéfiques de la pacification de l'Empire romain et de la politique impériale d'Auguste. Le poète critique régulièrement le luxe abondant de ses contemporains, sans arrêt tourmentés par de nouveaux désirs, à rebours de la quiétude d'une existence modeste. L'unique remède à la décadence est le retour à la religion et aux mœurs des aïeux. C'est pourquoi Horace se place parfaitement dans les réformes morales qu'Auguste mettait en place. Mais ses Odes furent mal accueillies par le public, et donc Horace dut retourner à la causerie morale en hexamètres dans ses Épîtres. Entre-temps, ses Odes furent mieux reçues, et Auguste pria l'artiste de composer un quatrième livre en -13. Il y glorifie la puissance de la poésie et démontre un certain orgueil. Pour la première fois, il aborde le genre de l’épinicie en célébrant les mérites guerriers de Tibère et de Drusus, beaux-fils de l'empereur. De plus, alors qu'à l'accoutumée il exprime sa reconnaissance de citoyen auprès d'Auguste, il s'adresse dorénavant à l'homme comme à un ami, prouvant le fort lien qui les unit. Du reste, c'est à son cher empereur que l'auteur dédie sa dernière ode, qui prouve la paix et la tranquillité de ses vers : « Tant que César est gardien de l'État, on ne verra point le calme banni par la fureur civile ou par la violence, ni par la colère qui forge les glaives et jette dans les inimitiés les malheureuses villes. »
Son lyrisme latin et son quatrain n'inspireront pas ses contemporains, qui préfèrent l’Énéide de Virgile et son esthétique plus homérique, tragique et épique, ou le côté plus laborieux et élégiaque d’un Catulle. Par contre, les vers d'Horace inspireront l’hymnique chrétienne grâce à la beauté sereine de sa retenue, mais également la Renaissance par rapport à son humanisme et le fait de recentrer l'homme au milieu de l'univers. Il l'avait prédit : il a su conquérir l'immortalité et devenir un poète sacré par la force de ses vers :
« J'ai achevé un monument plus durable que le bronze, plus haut que la décrépitude des royales Pyramides, et que ne saurait détruire ni la pluie orageuse, l'Aquilon emporté, ni la chaîne innombrable des ans, ni la fuite des âges. Je ne mourrai pas tout entier, et une bonne partie de mon être sera soustraite à Libitine ; sans cesse je grandirai, toujours jeune par la louange de la postérité (...) j'ai le premier annexé le chant d'Éolie aux cadences italiennes. Prends un orgueil que justifient mes mérites, Melpomène, et viens, de bon gré, ceindre ma chevelure du laurier delphique. »
Ed. Les Belle Lettres, 2002
Traduction de François Villeneuve