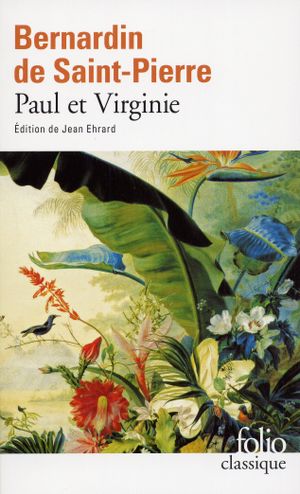Malgré le fort pathos et le style parfois se détachant difficilement de Jean-Jacques Rousseau, Paul et Virginie reste une œuvre éblouissante et une rêverie poétique sur un âge d’or disparu. Pastoral romanesque ultime, le livre de Bernardin de Saint-Pierre peut paraître naïf, mais c’est là d’où provient toute la noblesse du roman. Noble parce qu’il suit l’éloquence du cœur de ses personnages et maintient une foi inébranlable dans l’idée d’adopter la voie de la nature et de la vertu. Paul et Virginie sont deux enfants, élevés ensemble et chacun par une mère seule sur l’Île-de-France, l’actuelle île Maurice. Ils grandissent comme des frère et sœur inséparables puis tombent amoureux naturellement avec le temps. Nés dans un cadre idyllique, ils vivent dans le pur plaisir de la nature, celle qui apaise les troubles malheureux de l’âme. Leur existence s’arrête aux frontières de leur île, ils ignorent tous les conflits, les livres, les sciences, les arts ou autres choses pouvant les tourmenter et les corrompre. Pour eux, chaque jour est une fête, car la communion est parfaite entre la création et sa créature, à l’image de cette phrase : « C’était sur ce rocher que ces familles se rassemblaient le soir, et jouissaient en silence de la fraîcheur de l’air, du parfum des fleurs, du murmure des fontaines, et des dernières harmonies de la lumière et des ombres. »
En effet, l’écrivain décrit une forme d’harmonie originelle où tout fait un et une petite société qui travaille rudement et avec labeur, mais ce n’est pas pour recréer la civilisation européenne, à l’instar de Robinson Crusoé. Ils travaillent pour vivre et non pour produire. La Providence a évidemment une importance fondamentale dans l’histoire. Mais contrairement à Robinson Crusoé, qui punit les méfaits du personnage puis le remet dans le droit chemin en lui envoyant les signaux adéquats, la Providence de Paul et Virginie n’a pas besoin de punir, dans la mesure où leur société est parfaite, car c’est celle, métaphoriquement, d’avant le péché originel. C’est donc d’abord un Dieu créateur à la fois abondant et généreux, auteur de la vie et qui incarne le cœur, principal organe de la nature et du monde. Il y a une évidente dimension déiste mêlée à de la contemplation, mais Bernardin de Saint-Pierre rappelle que Dieu est l’auteur de la raison universelle et d’une harmonie simultanément salutaire et infinie. Pour ces raisons, on se trouve dans une forme de déisme évangélique et panthéiste dont l’extrait suivant résume bien la pensée métaphysique de l’ouvrage : « Ils raisonnaient peu sur ces livres sacrés ; car leur théologie était toute en sentiment, comme celle de la nature, et leur morale tout en action, comme celle de l’Évangile. »
À partir de là, l’auteur instaure une limpidité et une innocence dans un univers champêtre et virgilien. Il est composé d’une beauté luxuriante où la nature est à la fois riche, féconde, aimable, variée et magnifique. C’est pourquoi le livre prend les proportions d’un songe symphonique dans lequel la nature paraît sans défaut. Cela, on le doit aux sublimes descriptions très imagées et personnifiées de son auteur, dont les talents de botaniste lui permettent une belle hétérogénéité dans ses esquisses exotiques et gracieuses. Il en résulte des peintures sensorielles et un spectacle végétal très doux, caressant et lumineux, qui nous berce gaiement, mais aussi mélancoliquement, à l’instar de ce passage, avant le départ de Virginie pour la France :
« Paul la suivit bientôt après, et vint se mettre auprès d’elle. L’un et l’autre gardèrent quelque temps un profond silence. Il faisait une de ces nuits délicieuses, si communes entre les tropiques, et dont le plus habile pinceau ne rendrait pas la beauté. La lune paraissait au milieu du firmament, entourée d’un rideau de nuages que ses rayons dissipaient par degrés. Sa lumière se répandait insensiblement sur les montagnes de l’île et sur leurs pitons, qui brillaient d’un vert argenté. Les vents retenaient leurs haleines. On entendait dans les bois, au fond des vallées, au haut des rochers, de petits cris, de doux murmures d’oiseaux, qui se caressaient dans leurs nids, réjouis par la clarté de la nuit et la tranquillité de l’air. Tous, jusqu’aux insectes, bruissaient sous l’herbe. Les étoiles étincelaient au ciel, et se réfléchissaient au sein de la mer, qui répétait leurs images tremblantes. Virginie parcourait avec des regards distraits son vaste et sombre horizon, distingué du rivage de l’île par les feux rouges des pêcheurs. Elle aperçut à l’entrée du port une lumière et une ombre : c’était le fanal et le corps du vaisseau où elle devait s’embarquer pour l’Europe, et qui, prêt à mettre à la voile, attendait à l’ancre la fin du calme. À cette vue, elle se troubla et détourna la tête pour que Paul ne la vît pas pleurer. »
Effectivement, il ne faut pas l’oublier, Paul et Virginie est le mythe d’un amour impossible. Mythe qui paraît éternel, puisque le récit est narré à travers un vieillard contant l’histoire des deux amoureux, desquels il fut proche, bien après leur disparition, à un jeune interlocuteur attentif à son discours. La suite, placée sous le signe de la mort, prend un ton beaucoup plus extrême dans sa sensibilité et surtout tragique. Le climat et ses éléments deviennent violents et changent à mesure que le mal inconnu s’instaure chez Virginie. Plus tard, par obligation, elle doit partir de l’île pour vivre en France, à cause d’une demande exprimée par sa tante veule et hypocrite voulant lui donner son héritage. Le déchirement est total pour Paul, tandis que sa famille est impuissante face à tant de tristesse. Cependant, la jeune fille revient, mais le navire est pris dans une tempête et s’apprête à couler. Alors qu’elle aurait pu nager plus facilement en se déshabillant, elle préfère, par pudeur, ne pas enlever ses habits. Par conséquent, elle se noie, malgré la tentative de sauvetage de Paul pour la soustraire à l’eau. Cela peut paraître très prude, mais il faut voir la scène comme symbolique. Cette pudeur, qui d’abord exprime le mal-être de la puberté et d'une sensualité cachée, est le reflet d’une obéissance et d’une fidélité aux lois de la nature, de l’amour et de la vertu. Virginie, dans un schéma chrétien de chute et de rédemption, paie les fautes de l’Europe et ses cruels préjugés. Sa mort est un adieu à cette petite société bucolique, car après le décès du personnage, tous les autres suivront son chemin dans la tombe. Bernardin de Saint-Pierre ne fait donc pas la morale à Virginie, mais à la civilisation européenne qui pervertit tout ce qu’elle touche. Elle détruit les Édens et tue l’innocence à cause de ses vices.
Ainsi, tout au long du roman, l’écrivain, particulièrement à travers la voix du vieillard plein de sagesse, préconise de préférer les avantages de la nature à ceux de la fortune. La société française a tendance à mettre de côté sa conscience au profit de la richesse et de l’ambition matérielle. Elle s’intéresse fort peu à la vérité, tant que ses désireux gouvernent. Ce n’est pas anodin que l’œuvre soit publiée peu de temps avant la Révolution française. En effet, le romancier critique l’assemblage de corporations de l’Ancien Régime. Il est vrai qu’elles apportaient stabilité, protection, solidarité et privilèges lorsque l’homme était bien établi à l’intérieur d’une de celles-ci. Mais elles devenaient un obstacle à l’épanouissement des talents et un frein aux initiatives économiques et au progrès en général pour les individus ne pouvant intégrer aucune corporation. Dès lors, ils ne pouvaient se définir ni trouver leur place en société. Ils devenaient des marginaux, des déclassés et même des hors-la-loi. C’est ce que dit le vieillard à Paul, étant donné que ce dernier est un enfant bâtard, lui qui rêvait de rejoindre sa Virginie pendant son absence, en s’imaginant construire sa place en métropole pour la retrouver. Ainsi, le vieux sage recommande plutôt : « Que Dieu soit votre unique patron, et le genre humain votre Corps ! »
Pour autant, Paul et Virginie n’est pas un traité politique ; cela reste d’abord une déclaration somptueuse et pleine de mélancolie sur l’adieu à la nature. Il faut relever également les laïus à propos de la solitude, à partir de laquelle l’homme peut trouver son bonheur. Le narrateur ne préconise pas foncièrement de vivre seul, puisque l’homme est lié au genre humain par tous ses besoins, mais la solitude permet de s’éloigner de l’agitation sociale et de rétablir les harmonies du corps et de l’âme. Par ailleurs, l’homme est moins tenté d’être médisant et haineux en pensant que chaque humain est mauvais, parce que la solitude permet de prendre de la distance avec les passions humaines et de prendre en pitié son prochain afin d’être plus altruiste. Enfin, malgré la douleur empathique liée à la mort de Virginie, Bernardin de Saint-Pierre accorde une réelle dimension quasi stoïcienne vis-à-vis de la mort. Le vieillard, en vain, tente de rassurer Paul en lui disant qu’ils auraient pu être malheureux de leur pauvreté et de son éducation européenne si elle était restée vivante. Surtout, la mort de sa bien-aimée était inéluctable, car : « La vie de l’homme, avec tous ses projets, s’élève comme une petite tour dont la mort est le couronnement. En naissant, elle était condamnée à mourir. »
La mort est inévitable ; par contre, les noms restent éternels, tels les appellations charmantes et pleines de candeur que donnaient Paul et Virginie dans les recoins vierges de leur île. Je ne peux m’empêcher de partager cet extrait du narrateur décrivant son impression à propos des mots qui sont forgés dans l’infini :
« Quelque plaisir que j’aie eu dans mes voyages à voir une statue ou un monument de l’antiquité, j’en ai encore davantage à lire une inscription bien faite ; il me semble alors qu’une voix humaine sorte de la pierre, se fasse entendre à travers les siècles et, s’adressant à l’homme au milieu des déserts, lui dise qu’il n’est pas seul, et que d’autres hommes, dans ces mêmes lieux, ont senti, pensé et souffert comme lui : que si cette inscription est de quelque nation ancienne qui ne subsiste plus, elle étend notre âme dans les champs de l’infini, et lui donne le sentiment de son immortalité, en lui montrant qu’une pensée a survécu à la ruine même d’un empire. »
Certes, l’île n’offre « plus que des ruines et des noms touchants », « semblable à un champ de la Grèce » ; néanmoins, le nom des deux protagonistes et leur histoire sont inscrits à tout jamais dans la postérité. Ce n’est pas pour rien que le livre eut une grande influence tout au long du XIXe siècle et inspira le mouvement romantique, de Chateaubriand à Lamartine. C’est par les mots de ce dernier dans son Graziella que je terminerai ma critique, et qui définissent Paul et Virginie comme : « ce manuel de l’amour naïf, livre qui semble une page de l’enfance du monde arrachée à l’histoire des cœurs humains et conservée toute pure et toute trempée de larmes contagieuses pour les yeux de seize ans. »