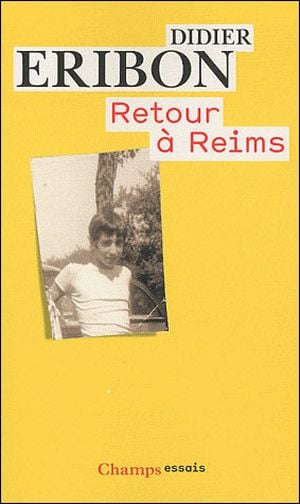La réputation d’Eribon le précède. Dans le trouple / trio d’intellos de gauche qu’il forme avec Geoffroy de Lagasnerie et Édouard Louis, il apparaît comme le mentor, la figure tutélaire, l'intellectuel engagé dans la Cité par excellence, quand Geoffroy de Lagasnerie est plutôt l'universitaire d’extrême-gauche médiatique (délaissant par ailleurs les logiques académiques ; Lagasnerie était connu il y a quelques années pour polémiquer sur la liste de diffusion de l’ANCMSP, un réseau de politistes, et j’ai moi-même pu y lire une de ses diatribes dans laquelle il regrettait le rétrécissement des SHS sur des micro-objets ; que plus personne n’ait l’envergure et l’ambition d’être, disons, Platon ou Aristote) et Édouard Louis l’écrivain, enfant chéri de la littérature tout droit sorti de la cuisse d’Annie Ernaux. Avec les spectres (encombrants) de Michel Foucault et Pierre Bourdieu pour compléter le tableau. On sait donc à peu près de quoi parle Retour à Reims, en 2025, avant de l’avoir lu – la littérature de transfuge étant devenue, depuis sa publication en 2009, un filon éditorial.
Au début, je me suis dit, ravi, que c’était du Édouard Louis intelligent. Et c’est bien mieux que ça. Dans la droite filiation de Bourdieu et Ernaux, Eribon analyse sa trajectoire exceptionnelle (au sens statistique et sociologique) d’enfant d’ouvriers devenu professeur d’université, spécialiste de Michel Foucault, ami de Pierre Bourdieu, figure du monde intellectuel de la fin du XXe siècle. Il entremêle le récit autobiographique des origines à l’auto-socioanalyse (Ernaux parle très justement d’autosociobiographie) pour raconter son parcours en explicitant les logiques sociales qui l’ont rendu possible. Il restitue la violence de sa classe à son égard (jeune intellectuel homosexuel, premier de sa famille à aller au lycée, puis à avoir le bac, entrer à la fac...) en la replaçant dans ses logiques sociologiques, sans l’accabler, et surtout sans utiliser les armes de sa nouvelle classe pour la tuer symboliquement (contrairement, donc, à ce que fit Édouard Louis dans Pour en finir avec Eddy Bellegueule).
Retour à Reims est un livre sur les classes populaires, sur sa famille, sur le XXe siècle, sur le passage d’un vote de classe pour le PCF à un vote de classe pour le FN depuis les années 1980. La troisième partie, sur le rapport au politique, est d’ailleurs savoureuse à lire aujourd’hui : Eribon écrivait il y a 15 ans ce que le champ médiatique feint de découvrir avec les récents succès électoraux du RN. Comme quoi, lire des livres, ça aide... C’est aussi, en sous-texte, le récit d’un passage de la philosophie à la sociologie. C’est un très beau livre sur Bourdieu (qui fit lui-même ce passage), avec des pages passionnantes sur son dernier livre, inachevé, Esquisse pour une auto-analyse, où Eribon lit un impensé sociologique et sexuel (p. 164-170, édition Champs de 2010), mais aussi une réaffirmation théorique de l’importance de la rupture épistémologique bourdieusienne contre les sociologies pragmatiques, accusées de reconduire l’ordre social :
Il faut être passé, comme ce fut mon cas, d’un côté à l’autre de la ligne de démarcation pour échapper à l’implacable logique de ce qui va de soi et apercevoir la terrible injustice de cette distribution inégalitaire des chances et des possibles. Cela n’a guère changé, d’ailleurs : l’âge de l’exclusion scolaire s’est déplacé, mais la barrière sociale entre les classes reste la même. C’est pourquoi toute sociologie ou toute philosophie qui entend placer au centre de sa démarche le “point de vue des acteurs” et le “sens qu’ils donnent à leurs actions” s’expose à n’être rien d’autre qu’une sténographie du rapport mystifié que les agents sociaux entretiennent avec leurs propres pratiques et leurs propres désirs et, par conséquent, à n’être rien de plus qu’une contribution à la perpétuation du monde tel qu’il est : une idéologie de la justification (de l’ordre établi). (p. 51-52)
Dans le registre autobiographique, je retrouve de belles notations lues récemment chez Maggie Nelson :
Sans doute les sentiments de dégoût que m’inspirent aujourd’hui ceux et celles qui essaient d’imposer leur définition de ce qu’est un couple, de ce qu’est une famille (...) et qui invoquent des modèles qui n’ont jamais existé que dans leur imagination conservatrice et autoritaire, doivent-ils beaucoup de leur intensité à ce passé où les formes alternatives étaient vouées à être vécues dans la conscience de soi comme déviantes et a-normales, et donc inférieures et honteuses. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi je me méfie tout autant des injonctions à l’a-normalité qui nous sont adressées par les tenants – très normatifs également, au fond – d'une non-normativité érigée en “subversion” prescrite. (p. 70-71)
Il y a aussi quelques pages savoureuses où il se paie Raymond Aron (p. 101-104), égérie de la droite intellectuelle modérée contemporaine, après des décennies de moqueries sartriennes (le fameux “je préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron”). Une amie m’a fait très justement remarquer que sa trajectoire de transfuge, de rupture totale avec sa famille, est permise par son genre et qu’Annie Ernaux ou Rose-Marie Lagrave n’auraient pas pu abandonner complètement leurs familles. Il ne le voit pas tout à fait. Dont acte. Pour tout ce que j’ai écrit au-dessus, pour la finesse avec laquelle la question homosexuelle et la question sociale sont tressées, Retour à Reims est bien un livre à l’intelligence éclatante, redoutable et généreuse, qui rappelle le potentiel émancipateur et libérateur du savoir, fût-il philosophique ou sociologique. Un de ces livres contemporains cultes, pour de bonnes raisons.
L’amitié n’échappe pas aux lois de la pesanteur historique : deux amis, ce sont deux histoires incorporées qui tentent de coexister, et parfois, dans le cours d’une relation, si étroite soit-elle, ce sont deux classes qui, par un effet d’inertie des habitus, se heurtent l’une à l’autre. (p. 176)