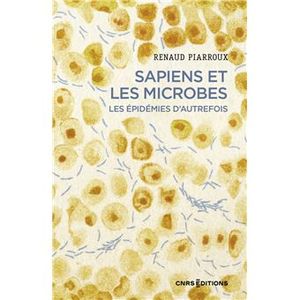Les âmes sensibles pourraient être prises d'un profond malaise à la lecture de cet extraordinaire essai de Renaud Piarroux tant il est clair que notre époque a perdu l'habitude de se confronter à l'atroce arbitraire des épidémies. Le COVID-19 avait rappelé à tous la vulnérabilité des sociétés face aux microbes même si elle n'avait finalement rien de comparable en Occident à ce qui avait pu être connu autrefois, et pour la dernière fois en 1918 avec la terrible grippe espagnole, qui avait tout de même tué entre 3 et 5 % de la population européenne. Pourtant, et Renaud Piarroux le note d'emblée, l'épidémie de 2020 a parfaitement illustré l'impact de la maladie contagieuse sur la société toute entière, à la fois de manière très concrète, dans les méthodes mises en place par les gouvernements pour freiner l'épidémie (confinements, limitations d'accès à l'espace public, vaccination, etc.) que dans les conséquences économiques et sociales de la maladie et des réponses qui lui ont été apportées. A côté du ralentissement économique, l'angoisse terrible d'une mortalité soudain revenue du fond des âges, particulièrement renforcée par la surcharge des hôpitaux, et la résurgence étonnante du mouvement antivax, dont Piarroux indique avec une érudition remarquable le caractère ancien, ainsi que les erreurs commises par certains médecins pourtant en vue, concourent à démontrer que l'épidémie récente n'avait rien de fondamentalement nouveau et qu'elle fut même incroyablement classique. Ni l'irrationalisme du complotisme réactionnel ni le caractère parfois autoritaire de mesures souvent mal expliquées aux citoyens n'ont révélé une face inédite d'Homo Sapiens dont Piarroux annonce avoir "trouvé" le reflet dans l'étude historique des épidémies. Cet essai qui s'ouvre sur l'illustration de l'épidémie de peste à Marseille en 1720, une des plus violentes et des mieux documentées de l'Histoire, parvient à dresser en 400 pages l'impact profond des maladies dans le déroulé de la destinée humaine. Un livre à lire absolument.
Les épidémies sont aussi vieilles que l'être humain lui-même, et les microbes qui en sont à l'origine ont une parenté avec Homo Sapiens, puisque les bactéries disposent d'ancêtres communs avec ce dernier. D'ailleurs, il est fort à parier que certaines bactéries se sont incorporées à nous dans les temps anciens. Ainsi, la cellule humaine, composée d'un noyau et d'un cytoplasme, s'est enrichie de bactéries qui sont devenues nos mitochondries. Notre corps est entièrement composé de cette petite faune qui nous aide à subvenir à nos besoins, notamment pour digérer, et qui permette d'empêcher naturellement à d'autres bactéries de s'implanter. Le corps a développé un mécanisme extraordinaire de régulation, les défenses immunitaires, qui permettent d'identifier un corps étranger et de l'éradiquer. Ce que l'on nomme maladie peut être causée par de multiples micro-organismes : la bactérie (peste, choléra, tuberculose, lèpre, coqueluche, tétanos, …), le protozoaire (le paludisme, la maladie du sommeil, la toxoplasmose) et évidemment le virus, dont la particularité est de se situer à la frontière entre le vivant et le non vivant (grippe, sida, fièvre jaune, variole, rubéole, etc...). Piarroux exclut de son champ d'étude les champignons et les algues. Toutes trouvent dans l'être humain un hôte nécessaire à leur prolifération et transmettent des informations, souvent par le biais de l'ADN ou de l'ARN (la différence est parfaitement expliquée dans le livre), et mutent en permanence. Confrontées à ces maladies, les défenses immunitaires s'organisent plus ou moins bien, la plupart du temps en permettant l'annihilation du micro-organisme. Quelques fois, la souche est si virulente et contourne si bien nos défenses immunitaires qu'elle cause de sérieux dégâts et même la mort. D'autres fois, les défenses immunitaires parviennent parfaitement à identifier la souche et à la combattre.
Il ne faudrait pas croire que toutes les souches ont un impact similaire sur notre système immunitaire. La plupart des virus que nous connaissons, comme le COVID, la grippe et autrefois la terrible variole, restent dans la mémoire de nos défenses immunitaires. Même si les virus mutent et se transforment, l'immunité permet à nos défenses immunitaires d'éliminer rapidement l'organisme déjà connu. C'est d'ailleurs le principe même de la vaccination : permettre au système immunitaire de reconnaitre et d'apprendre à combattre un micro-organisme. Certains virus, comme la grippe et le COVID, composés d'ARN, parviennent à se recombiner régulièrement et à muter, prenant parfois de vitesse les défenses immunitaires, ce qui explique des vagues multiples et donc des campagnes de vaccination annuelles. D'autres virus, dont l'un des plus mortels que fut la variole, a été éradiqué par une campagne de vaccination mondiale.
Parfois, il n'en va absolument pas de même, notamment avec les bactéries. Les maladies deviennent alors chroniques, et avant l'existence des traitements ou des antibiotiques, finalement découverts assez récemment, restent dans l'organisme et refont surface régulièrement. La maladie la plus meurtrière de notre histoire, la tuberculose, est éternelle et mène vers une mort certaine ses hôtes : il en va de même de la lèpre qui est une maladie ancestrale. Piarroux compare ces bactéries avec les poux de corps qui s'installent durablement chez l'humain et s'installent dans les communautés, mutant en même temps que ses hôtes. Certaines d'entre elles trouvent par ailleurs des parades monstrueuses pour se développer dans l'organisme. Tel est le cas de la peste dont l'inoculation se fait à l'origine par la piqûre d'une puce de rat. La bactérie de la peste parvient à neutraliser la cellule de reconnaissance qui développe les anticorps (qui sert a adapter la défense immunitaire aux antigènes) et à se multiplier dans les ganglions lymphatiques, passant alors dans le sang et amenant à une mort certaine en quelques jours. La bactérie du choléra, elle, était à l'origine totalement bénéfique jusqu'à ce qu'un "phage", un virus de bactérie, entraîna une mutation qui causa le développement d'une toxine amenant à une maladie épouvantable, qui tue en quelques heures ou jours, par la déshydratation immédiate. Quant aux protozoaires, comme le paludisme, il passa du gorille à l'homme par l'intermédiaire de la piqûre d'un moustique, l'anophèle, très présent dans les milieux tropicaux, et a comme particularité de se reproduire avec un système de gamètes mâle et femelle, modifiant les antigènes et neutralisant les défenses immunitaires. Les populations africaines, pour y survivre, développèrent une maladie génétique, la drépanocytose, qui paradoxalement leur permit d'y survivre. Pour ces micro-organismes là, les méthodes de luttes furent très difficiles à identifier alors qu'elles étaient parfois simples. A titre d'exemple, la réhydratation permet la rémission du choléra : les médecins d'autrefois pratiquaient des saignées, soit l'exact contraire de ce qu'il fallait faire.
Renaud Piarroux indique que les recherches phylogénétiques sur les épidémies, qui permettent de retracer l'histoire des pathogènes, présentent un aspect très complexe. Il est au demeurant presque impossible pour les virus, qui sont massivement composées d'ARN qui se périme très vite. Les bactéries et les protozoaires sont composées d'ADN. Il faut bien comprendre que l'ADN, qui se trouve dans le noyau des cellules, est une sorte de banque d'informations composée de quatre éléments, des nucléotides, agencées de manière complexe : A (adénine), G (guanine), C (cytosine) et T (thymine). L'ARN, qui découle de l'ADN, est une sorte de photocopie d'information envoyée dans le cytoplasme pour la production des protéines associées, et n'est pas composée de thymine mais d'uracile. Néanmoins, partant de là, les recherches ont découvert l'existence, sur les os, de maladies très anciennes, accompagnant l'homme depuis le début de son histoire, comme la tuberculose ou la lèpre. Les bactéries passent souvent d'une espèce à l'autre et évoluent en même temps qu'elles, se séparant petit à petit de leurs cousines. Ainsi, les chimpanzés partagent avec l'homme des maladies, la lèpre ou la tuberculose toujours, mais elles ne sont plus substituables. Pour schématiser, les groupes de chasseur cueilleurs étant plus petits, les épidémies s'installaient dans des groupes et ne circulaient pas aussi facilement d'un groupe à l'autre. Si des virus émergeaient, ils ne pouvaient pas aussi aisément qu'aujourd'hui se propager massivement et tuaient ou immunisaient un groupe restreint d'individus.
Avec le Néolithique et l'émergence de l'agriculture, puis des centres urbains, les virus à immunité commencèrent à faire de sérieux ravages, principalement en Eurasie : ainsi, la variole, née vraisemblablement en Afrique du Nord il y a trois mille ans, et dont les liens avec la "variole du singe" actuelle sont établis, causa des épidémies au Proche Orient. Elle tua vraisemblablement massivement à Athènes lors de la Guerre du Péloponnèse (-431) et lors de la Peste d'Antonin entre 165 et 180 à Rome. D'ailleurs, l'Empire Romain connaissait une mortalité infantile terrible à cause du paludisme (mais aussi de la lèpre ou de la tuberculose). Sans déstabiliser fondamentalement les sociétés, elles entraînaient des pics de mortalité ahurissants aussi bien en Europe, qu'au Moyen Orient, qu'en Inde ou en Chine, suivant les routes commerciales. C'est bien l'émergence d'une globalisation, voire d'une mondialisation, qui permit une telle mortalité avant immunité. La bactérie de peste est typiquement une illustration parfaite du rôle des échanges dans la propagation des épidémies. La bactérie est vraisemblablement née sous une forme moins virulente en Asie Centrale dans des colonies de marmottes avant de passer à l'homme et de se diffuser au Proche Orient puis en Europe, causant une pandémie terrifiante à Constantinople, en raison de l'activité portuaire de la ville, en 549, facilitée par un épisode climatique de refroidissement généralisé (lui même du à l'éruption d'un volcan). La peste s'installa durablement et causa de régulières épidémies qui terrifiaient les populations au delà du possible. Par l'intermédiaire du peuple mongol, peut-être par l'intermédiaire d'un geste de bioterrorisme à Caffa (c'est néanmoins contesté), elle atteignit des comptoirs génois de la Mer Noire et causa la mort d'un tiers à la moitié de la population européenne en 1348 en pleine Guerre de Cent Ans. Jamais une telle proportion de mortalité n'avait été atteinte. Toutefois, les sociétés continuèrent à se perpétuer, sans d'ailleurs fondamentalement se désorganiser. A la Renaissance, l'épidémie de syphilis, causée par une bactérie en provenance d'Hispaniola et ramenée par les hommes de Christophe Colomb, est un autre exemple. Les miliciens espagnols qui défendaient Naples contre les troupes françaises lors des Guerres d'Italie causèrent indirectement un immense drame en Europe (les militaires étaient de grands amateurs de prostituées). Il en ira du même des épidémies de choléra, qui trouvaient leurs sources dans le Gange Indien, et qui terrifia entre 1500 et 1800 les populations européennes. A chaque fois, ces maladies suivaient le commerce ou les guerres.
Ce qui m'a profondément étonné est la résilience des sociétés. Malgré des morts très nombreux, dans une proportion sincèrement colossale, la vie continuait et se réorganisait. Lors des épidémies, les économies pouvaient être à l'arrêt. Souvent, ces maladies, dont les origines étaient inconnues, étaient instrumentalisées par les autorités religieuses et interprété comme des punitions divines à des péchés. Les médecins, eux, identifiaient mal les mécanismes de contagion. La théorie dominante, le paradigme pour reprendre l'expression de Kuhn, dans la droite ligne d'Hippocrate et de Galien, assimilait les maladies à un déséquilibre des humeurs dans le corps (sang, lymphe, bile jaune, bile noire) causé par des miasmes. Il faudrait attendre très longtemps avant que l'existence des microbes ne soit découverte. Mais certains médecins, et même le bon sens populaire, avaient identifié la contagiosité des maladies. L'isolement des malades dans les hôpitaux (où ils subissaient tout de même des purges, des saignées et autres traitements qui aggravaient leur état) préservait leurs proches. Les ports mirent rapidement des systèmes de patente (certificats de bonne santé) et de quarantaine à l'égard des navires ce qui aida à préserver les sociétés, même si les microbes passaient parfois entre les mailles du filet, causant à Marseille, en 1720, une hécatombe terrifiante. Les solutions n'ont guère vraiment changé : le confinement utilisé en 2020 étant dans la droite ligne de ce qui existait auparavant. Toujours, l'humain vivait avec la maladie et subissait avec une forme d'acceptation étonnante les épidémies.
Renaud Piarroux s'attarde sur l'épisode des Grandes Découvertes et la colonisation de l'Amérique et de l'Océanie par des migrants européens. Il pointe ce que l'on savait déjà, à savoir le rôle majeur des microbes dans la suprématie européenne sur des populations innombrables. L'Amérique, peuplée par 60 millions d'habitants, contenait des civilisations anciennes et parfaitement organisées, ainsi qu'une faune et une flore adaptées. Un petit nombre de conquistadors, à l'image de Colomb, de Cortès ou de Pizarro se rendirent maîtres d'espaces immenses. Bien sûr, l'animosité des Européens, leurs politiques d'alliance et leur brutalité, ainsi que l'imposition d'un système économique fondée sur la propriété foncière et l'esclavage, eurent un rôle dans la disparition des indigènes. Certaines spécificités des sociétés indigènes elles-mêmes participèrent sans doute à expliquer le phénomène. Néanmoins, c'est bien les maladies auxquelles les Européens étaient immunisés qui causèrent l'extinction, jusqu'à 90 %, des populations locales. A Hispaniola, qui deviendra Haïti, les Taïnos disparurent totalement. La variole fut vraisemblablement à l'origine de cette hécatombe même si d'autres maladies, dont certaines sont inconnues encore aujourd'hui (la fièvre jaune ? la dysenterie?), frappèrent à leur tour. La maladie fut également parfois propagée volontairement par les Européens, notamment en Amérique du Nord, dans un but de guerre. D'autres maladies s'installèrent également durablement comme la tuberculose. Plus intéressant, le commerce triangulaire permit l'implantation du paludisme africain en Afrique du Sud par l'importation des anophèles et d'esclaves noirs contaminés. L'Amazonie se vida totalement de ses habitants. Moins connu, et Renaud Piarroux en parle longuement de manière passionnante, l'Océanie connut également une dramatique baisse de la population en raison des épidémies, près de 95% par endroit. Piarroux cite des études concernant l'île de Rappa ou encore l'épidémie de syphilis à Tahiti : absolument passionnant. La maladie fut donc un instrument de domination coloniale particulièrement efficace sans lequel il aurait été bien plus difficile d'assujettir les populations et de subtiliser leurs ressources. Les épidémies furent parfois volontairement et d'autres fois involontairement des armes bactériologiques redoutablement efficaces.
La Révolution Industrielle et l'exode rural furent d'abord des facilitateurs d'épidémies en raison des conditions de vie insalubres de citadins. Néanmoins, les élites furent vite convaincues que la mortalité des classes dangereuses, notamment des ouvriers, pèseraient fortement sur la rentabilité de leurs commerces et de leurs usines. Convaincus que les miasmes corrompaient l'air de la ville, les hygiénistes impulsèrent des politiques d'assainissement des eaux usées et d'urbanisation nouvelle, à l'image de Hausmann en France. Certains médecins, comme le célèbre anglais John Snow, identifièrent parfaitement que les épidémies de choléra provenaient des eaux usées. Ces politiques, ainsi que l'essor des sanatoriums, permirent de limiter radicalement les épidémies de peste, de choléra et également d'atténuer l'impact de la tuberculose sur la population. En parallèle, l'Angleterre, derrière la figure de Lady Montagu, commença à pratiquer la pratique de la variolisation qui consistait à exposer des enfants à des souches de variole afin de les immuniser. Le médecin britannique Edward Jenner inventa alors la "vaccination" en inoculant une souche de variole bovine à ses patients. Bien que très efficace, la pratique fut longtemps contestée par le corps médical. Elle fut néanmoins appliquée strictement par Napoléon qui l'imposa à ses troupes avec succès. Il faudra attendre le génie médiatique d'un Louis Pasteur pour convaincre la communauté médicale de la validité scientifique du vaccin, de la nécessité de la pastorisation et surtout de son invention du vaccin contre la rage. En Allemagne, un génie comme Robert Koch découvrit l'existence de la bactérie (certains avaient identifié l'existence des micro organismes sans jamais le prouver) ce qui permettra à Fleming d'inventer l'antibiotique dans les années 1920. Une émulation entre les pays européens permit une foule d'invention et de découvertes, jusqu'à l'identification par Alexandre Yersin de la bacile de la peste en Chine. Tout cela ne sortait pas de nulle part : la médecine expérimentale se développait depuis 1800 et se focalisait sur l'étude de cas. L'amélioration de la pratique médicale, de l'hygiène des hôpitaux (l'importance du lavage des mains identifié par le médecin hongrois Semmelweis) et des connaissances scientifiques eurent un impact extraordinairement positif sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Après l'épidémie de la Grippe Espagnole, l'Europe atteint un tel degré de confort et de science qu'elle put éradiquer une grande part des maladies qui lui causaient autrefois tant de soucis.
Mais tout cela avait un aspect négatif. D'abord, les maladies infectieuses continuaient à faire des ravages dans le Tiers Monde : le choléra faisait encore des ravages à Haïti en 2010. Surtout, la colonisation européenne causait toujours, non plus des extinctions de population, mais l'émergence de nouvelles maladies. L'Afrique fut touchée au fil d'une longue colonisation par des bouleversements environnementaux. Les Européens avaient bouleversé les sociétés et les économies en vue d'extraire les richesses africaines. Tout cela permit l'émergence de nouvelles maladies, comme la maladie du sommeil, parce que la mouche tsé-tsé avait perdu son environnement naturel. Les conditions sanitaires désastreuses des chantiers de constructions des chemins de Fer au Congo Français et Belge, et dans l'Afrique Equatoriale Française, causa sans doute l'origine du SIDA mais également de terrifiantes épidémies sur les populations locales. Plus troublant, les Européens entreprirent des campagnes de vaccination et de traitement des maladies qu'ils imposèrent de manière autoritaire aux populations africaines. Si certaines de ces campagnes permirent des progrès, d'autres causèrent de nouvelles épidémies. Ainsi, les campagnes de vaccination, sans désinfection des seringues, causèrent l'émergence de l'herpès C en Egypte (et sans doute du SIDA en Afrique Centrale). L'impact de certains traitements provoquèrent la cécité de nombreux africains ce qui servit parfois d'expérimentations pour la création de nouveaux médicaments. La lutte contre la bilharziose ou la fièvre jaune provoqua paradoxalement l'émergence de parasites et de virus dont la létalité sera terrifiante, y compris pour les Occidentaux. Le dernier effet pervers est qu'un fossé se creusa progressivement entre les élites et les classes populaires : ainsi, dès les premiers pas de la vaccination en Amérique, des associations antivax se développèrent par hostilité. Naturellement, ces résistances existaient dans les colonies. Cela provoqua, lors de l'épidémie de COVID 19, des réactions d'hostilité terrible. Le manque de transparence des autorités fut toujours un problème. Pendant la grippe espagnole, les autorités militaires cachèrent la réalité de l'épidémie pour ne pas affecter le morale des troupes. La conséquence en fut le développement de foyers d'infection dans les camps militaires et la mort nombreuses d'hommes jeunes en pleine santé. De même, la négation des effets secondaires des vaccins, notamment contre la variole, n'aidèrent pas à gagner la confiance des citoyens. Les erreurs des médecins et leurs difficultés à se mettre à jour furent souvent funestes. Quant au complotisme, il est de tout temps : les Juifs et les étrangers furent toujours désignés comme à l'origine des épidémies de peste, de choléra et de lèpre. A Haïti, on accusait des empoisonneurs de propager le choléra par la "poudre blanche". Beaucoup considèrent encore que le SIDA fut une invention de la CIA. Décidément, l'épidémie de COVID 19 ne fut pas nouvelle. L'homme semble toujours le même des siècles après la peste de Justinien. Et le livre de Renaud Piarroux d'une extraordinaire utilité pour l'avenir.