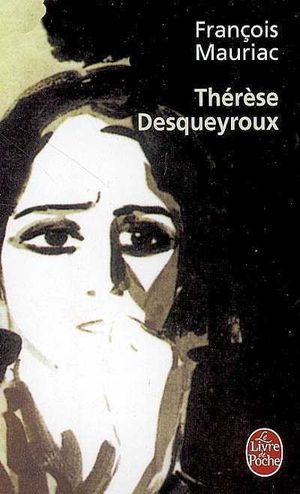Avec Thérèse Desqueyroux, François Mauriac explorait le grand thème de la lente mort de l'âme et de l'esprit. Douloureux sujet qui était déjà au coeur des « Trois soeurs » de Tchekov ou de « Mme Bovary » de Gustave Flaubert, par exemple.
Mariages de convenance et de raison, désespoir hantaient toutes ces oeuvres. L'inéluctable, lent et sûr tourment de la province, l'ennui rongeait ces héroïnes littéraires, reflets de tant de femmes emmurées vivantes. Relâchement moral, folie par perte de sens et criminalité par glissement vont dominer Thérèse, elle-même victime d'un assassinat conjugal par asphyxie.
En 1927, Mauriac disséquait donc l'effondrement d'une âme mais aussi celui d'une société bourgeoise et conformiste qui ne disparaitra véritablement que longtemps après en France.
La structure de ce chef d'oeuvre, allie la finesse de l'étude psychologique de ce « monstre » à sa mise en relief par une nature tour à tour étouffante (la chaleur, les landes et l'incendie), ou glaciale (la pluie, les vents). Les rites (les constantes chasses au fusil ou au filet, les fêtes religieuses et les messes) accentuant encore l'isolement de Thérèse.