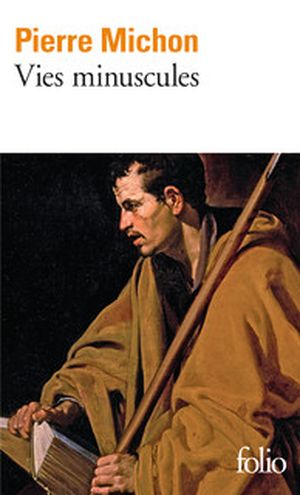Vies minuscules de Pierre Michon retrace l’existence de personnages proches de la vie de l'auteur. La difficulté d’écrire est exprimée dans les diverses recherches du narrateur, la retranscription du réel et de la vie chaotique de ses personnages. On est témoins de l’origine provinciale des personnages, de la peur de l’auteur envers le « lecteur parisien », du juge intransigeant que représentent les maisons d’édition parisiennes. Lui se sent tel le père Foucault comme un « illettré » incapable d’écrire ; le passage par l’hôpital psychiatrique ou le passage sur les ombres errantes de l’alcoolisme étouffent le narrateur. Tout cela est raconté avec talent et sagacité. Lorsqu’il se fait passer à tabac pour excès de correction verbale, le détachement du narrateur est comique. Il en rit en crachant du sang. Et l’on sourit avec lui, car l’exercice d’écriture devient exercice de vie.
« des mots et du temps, des mots jetés en vaine pâture au temps, n’importe quels mots, les faussaires et les véridiques, les bien sentis et les insensibles, l’or et le plomb, précipités avec perte et fracas dans le courant toujours intègre, insatiable, béant et calme. » Vies minuscules
Le plus touchant, c'est peut-être l’évocation de ce fantôme : la sœur de l’auteur, Madeleine, née en 1941 et morte prématurément. Le texte retrouve sa poésie en prose des deux premières « vies » et est véritablement poignant et ciselé. Le style de Michon me semble l’héritage d’une tradition littéraire qui est longuement citée dans le texte (Flaubert, Bernanos, Rimbaud, Conrad, Faulkner, Proust, Pascal, etc.). Il me semble qu’un des auteurs qui n’est pas cité et qui pourtant m’interpelle par sa présence fantomatique est Théophile Gautier :
« En faisant ce métier d'échanson, Bilot affectait une religieuse gravité ; on eût dit un prêtre de Bacchus officiant et célébrant les mystères de la dive bouteille ; il ne lui manquait que d'être couronné de lierre ou de pampre. Ces cérémonies augmentaient la valeur du vin qu’il servait, lequel était réellement fort bon et plus digne d’une table royale que d’un cabaret. » Le Capitaine Fracasse 1863
Ceci fait écho au passage suivant :
«Les consommateurs boueux et taciturnes levèrent la tête; Jean, l’œil allumé, était attablé avec L’abbé Bandy. Entre eux, un litre de vin rouge, aux trois quarts vide ; le teint égal des crapuleux compères tachait malsainement leur visage fatigué ; je me doutai qu’ils n’étaient pas aux premières libations. » Vies minuscules
Dans cet extrait de Michon, il y a utilisation d’épithètes littéraires comme taciturne ou l'adverbe "malsainement":
«Rien n'a racheté la fatigue de quatre heures de spectacle dans une salle chaude et malsainement odorante. » Barbey d'Aurevilly, Premier Memorandum: 1836
éminemment daté donc, ce qui est avoué dans la dernière partie, la dernière vie, qui admet utiliser un vocabulaire compassé pour un texte écrit en 1984. Mais, n’est-ce pas là toute sa gloire, sa beauté et son intérêt ? Une écriture délicieusement désuète. C’est un régal, parfois tragique. Tout l’intérêt de ce récit de Pierre Michon tient dans sa langue, mais également dans le fait qu’il fait revivre les morts, les gens des campagnes, des morts aux vies minuscules.