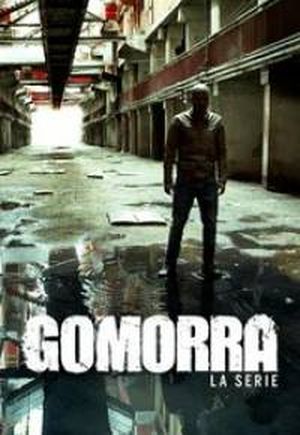Gomorra, c’est le chef-d’œuvre absolu du narco-réalisme européen. Pas d’effets de style inutiles. Juste la vérité crue, sale, désespérée et la puissance tragique de ceux qui vivent et meurent sous la loi du clan patriarcal.
Le jeu des acteurs est phénoménal, à commencer par Salvatore Esposito (Genny), Marco D’Amore (Ciro) ou Fortunato Cerlino (Don Pietro) : aucun ne surjoue, chacun habite son rôle avec une intensité dérangeante. Leur regard en dit plus long que tous les dialogues.
Le scénario, lui, serre la gorge et casse les repères moraux. Pas de héros. Pas de morale. Juste la loi du plus rusé, du plus froid, du plus désespéré.
Mais c’est surtout la place de la religion catholique qui sidère : on prie la Vierge entre deux assassinats, on jure sur Dieu avant d’exécuter un proche. Dans cette Naples gangrenée, la foi est un vernis sur l’abîme. La seule justice qui reste, c’est celle de Dieu. Celle de l’État ? Une rumeur lointaine. Gomorra révèle une société où le sacré et la barbarie cohabitent sans se contredire.
C’est une fresque politique. Une autopsie sociale. Un opéra napolitain sans musique, où les enfants deviennent soldats, les mères deviennent stratèges, et la ville devient un labyrinthe de trahisons. C’est l’Italie d’aujourd’hui, mais c’est aussi notre monde à nu : là où l’ordre s’effondre, la violence prend le trône.
Verdict : Gomorra ne glorifie rien. Elle documente. Elle dit l’horreur sans filtre, avec une précision chirurgicale. Et dans le silence qui suit chaque exécution, on entend battre le cœur d’un monde qui ne croit plus en lui-même.