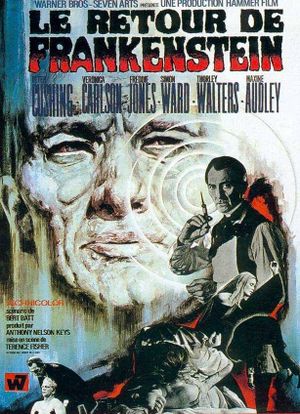Frankenstein must be destroyed a l’intelligence de peindre le docteur sous les traits de sa créature, c’est-à-dire tel un être composite animé par les différents corps qu’il s’approprie, en témoigne la séquence d’agression en chambre ressemblant aux agissements d’un vampire. Terence Fisher s’attache en effet à l’absence de reconnaissance, qu’il décline du plan scientifique, faisant du baron un génie incompris qui n’a que le mot « progrès » à la bouche, au plan affectif à mesure que la relation réciproque entre les personnages devient triangulaire : la belle maîtresse de maison voit vivre sous son toit deux hommes, l’un étant le bourreau de son compagnon, qui tendent à se confondre par une dégradation du corps de l’un au profit de la vigueur retrouvée du corps de l’autre. En parallèle, deux docteurs échangent malgré eux leur cerveau respectif, de sorte à rendre méconnaissable l’époux quand ce dernier se présente à sa moitié sous les traits de l’autre. L’ouverture, en tout point remarquable, préfigure ce vertige d’autrui entendu comme double potentiel : la malle qui semble circuler en autonomie, filmée en mouvement par des gros plans, contient l’autre visage de celui qui avance masqué – nous ne percevons d’ailleurs que sa silhouette –, métaphore que reprendra la trilogie Basket Case (Frank Henenlotter), dont le premier film sortira treize ans plus tard.