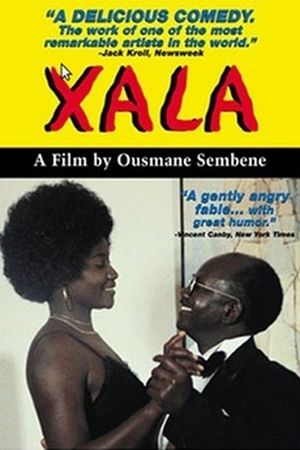Malgré peu de moyens de production, l'écriture de Sembène et sa direction d'acteur réussissent toujours à nous prendre aux tripes. Il aborde frontalement le sujet du colonialisme et du capitalisme, avec également son thème de prédilection: tradition vs. modernité. Dans les cinq premières minutes seulement, il fait une satire critique du gouvernement Sénégalais, qui en apparence s'est affranchi du pouvoir colonial, mais est en réalité toujours corrompu par les hommes d'affaires venant de l'Occident. Ces hommes noirs, nouvellement en charge, jettent dehors les bustes de statues occidentales. Peu après, ils acceptent en ricanant des mallettes de billets de ces mêmes hommes qu'ils ont virés. Plus tard dans le film, ils forcent même l'un de leurs collègues à parler le français plutôt que le wolof. Le président de la chambre de commerce, bien qu'il soit certes noir, est toujours accompagné du même homme d'affaires blanc. Le protagoniste du film, l'un des membres corrompus de la chambre de commerce, est le principal véhicule de la satire, un homme pleins de contradictions et hypocrite. Lorsque sa fille se plaint du fait qu'il s'apprête à se marier à une troisième femme, il la réprimande, déclarant qu'ils se sont affranchi de l'influence coloniale et que la polygamie fait partie de leur patrimoine religieux. En même temps, il refuse de pratiquer certains rituels traditionnels qu'il considère comme humiliants et datés. On peut ressentir la colère de Sembène vis-à-vis de son protagoniste, qui représente les hommes complices de l'oppression des populations Sénégalaises. Il lui fait subir un parcours humiliant tout au long du film, jusqu'au plan final qui est plein de rage. Son fameux xala, le fait qu'il n'arrive plus à bander, est sa préoccupation première, ce qui devient d'autant plus ridicule lorsque Sembène introduit l'intrigue secondaire des mendiants à deux doigts de la mort, affamés et assoiffés.