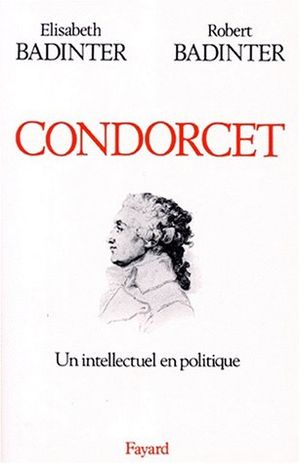Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet.
Un nom d'une noblesse d'héritage familial, porté par un homme d'une noblesse d'esprit. Condorcet était bien des choses : philosophe, mathématicien, académicien, juriste, journaliste, politique. Il est difficile de s'imaginer comment un homme aussi sensible et intelligent a pu vivre il y a plus de deux siècles. Lorsqu'on se penche sur sa pensée philosophique, sa vision politique et ses écrits, il serait aisé de croire qu'un tel individu soit issu du XXe ou XXIe siècle, et pourtant... Anti esclavagiste, féministe, contre la peine de mort, républicain, démocrate, rien ne manque à Condorcet pour être un penseur exceptionnellement en avance sur son temps.
Sa formation intellectuelle est assurée par ses pères spirituels que sont D'Alembert, Voltaire et Turgot. Il porte le culte de la raison, le mépris de l'ignorance et des superstitions, la passion des Lumières. A la veille de la Révolution, Condorcet est d'ores et déjà épris des idées philosophiques révolutionnaires que les évènements l'amèneront à défendre sur la scène politique. Ses ennemis le nomment « le mouton enragé », en référence aux violents pamphlets qu'il rédigeait, affligé par l'injustice dans l'affaire Lally notamment.
Républicain, Condorcet l'est après la fuite du roi et y consacre un discours le 8 juillet 1791, alors que la majorité des révolutionnaires n'y songent pas un instant, Robespierre compris… Ironique de se dire que ce dernier le persécutera pour mise en danger de la République. A l'automne 1791, enfin investi de la confiance du peuple, Condorcet arrive à l'Assemblée pour endosser le rôle qui lui était destiné de prendre, celui d'un homme qui par sa modération, sa sagesse, son érudition, s'évertuera à prôner l'unité des Républicains dans un contexte insurrectionnel en ébullition.
Le mouton enragé désapprouvait les débordements sans forcément les condamner. Tiraillé entre son amour du peuple et son dégoût des agissements de Marat et Robespierre qui incitent à la violence, son caractère silencieux et indécis confirme son embarras. Comment dénoncer la barbarie sans décrédibiliser la révolution ? Comment prôner la justice impartiale quand la Convention inflige un procès inique au Roi ? Comment contenir les ardeurs sanguinaires des révoltes populaires sans affaiblir la légitimité de la République ? Condorcet pensait remédier à cela en s'adonnant jour et nuit depuis l'automne 1792 à la rédaction d'une Constitution. Ne recevant que le mépris de la Montagne lorsqu'il présente son projet le 15 février 1793, Condorcet réalise que son légalisme est dépassé par les passions qui dominent l'Assemblée.
A l'instar de ses « amis » girondins qu'il ne soutient plus depuis septembre 1792, il ne saisit pas la gravité de la barbarie dans son entièreté. Sa volonté de « terminer » la Révolution fait sans cesse face aux intrigues et luttes de pouvoir. Refusant de choisir un camp avant le dénouement, Condorcet s'apercevra de son erreur dans les larmes quand les principaux députés girondins monteront sur l'échafaud le 31 octobre 1793. Devenu proscrit à son tour, sa fin de vie est celle d'un homme abattu, épuisé par les combats politiques qu'il a tenté de remporter par la raison. Mais la tyrannie a ses raisons que les Lumières ne connaissent pas.
L'héritage est pourtant évident. La défaite d'une vie s'avère être une victoire dans la mort. L'Etat de droit existe, l'esclavage et la peine de mort sont abolis, la femme est juridiquement l'égale de l'homme, l'instruction publique est institutionnalisée. Les Lumières l'ont donc emporté sur l'obscurantisme même si nous ne sommes jamais à l'abri. Les menaces contre la République ne seront jamais totalement éradiquées et le peuple en sera toujours le principal instrument. Souvenons-nous alors du nom de Condorcet et gardons en mémoire le courage d'un homme juste et intègre qui a donné sa vie pour ses idées, pour la liberté, pour la République et pour la Nation.