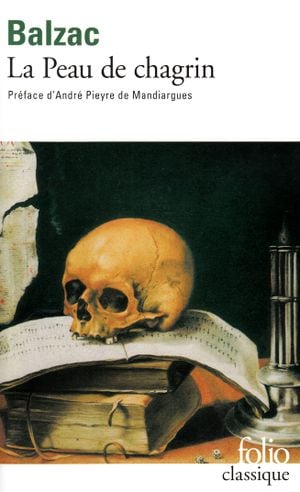Je retrouve, bien des années plus tard, pourquoi, jeune lecteur, je n'aimais pas tant lire Balzac. Il ya dans La peau de chagrin de magnifiques descriptions, une structure en miroir virtuose, des passages qui valent pour eux-même, comme cette discussion entre médecins qui semble sortie d'un livre de Molière.
Mais....
La langue trop précieuse est déjà un frein, surtout quand elle prend le pas sur l'intrigue, qui se retrouve comme bâclée, quand elle n'est pas trop étirée. Sans doute peut-on y voir une métaphore de la peau de chagrin du titre : plus elle est grande, plus l'intrigue est étirée, plus elle se rétrécit, plus l'intrigue se recentre avec.
Soit...
Si je vois bien le côté brillant, j'avoue qu'il m'a laissé de marbre. La faute par exemple à une très longue scène de banquet où Balzac résume son époque, d'une façon qui interdit au lecteur actuel qui ne serait pas spécialiste de la question, de s'en tirer sans les notes en bas de page. Notes qui permettent la compréhension, certes, mais comme on comprendrait un objet d'étude. Cela exclut la passion.
Et puis...
La résolution de l'intrigue se fait à coup d'ellipses : ce qui importe est d'avoir une succession de tableaux, plus qu'une histoire. Comme dans un tableau, les personnages en ressortent figés, réduits à leur fonction archétypale.
Et le fantastique?
Chez Nathaniel Hawthorne, la faiblesse, si faiblesse il y a, vient que l'auteur n'y croit pas, et semble sans cesse s'excuser de ses invraisemblances. Chez Balzac, il semblerait que ce soit l'inverse : il paraît y croire fort, et cela engonce parfois le récit dans un mysticisme abscons où l'on mélange Mesmer, époque oblige, avec des considérations ésotériques, où l'on rit de la science, incapable qu'elle est de reconnaître qu'il y a des champs où elle ne peut s'appliquer. Cela donne certes le savoureux passage où l'on tente d'étirer à nouveau la peau de chagrin. Mais la faiblesse, si faiblesse il y a, est que l'on veut absolument nous faire croire à l'inconcevable, là où laisser le mystère tel quel aurait donné une ambivalence bien plus dérangeante. Poe avait parfaitement réussi le mélange : croire à ses histoires sans ressentir le besoin de les expliquer.
C'est ce qu'on appelle la foi. Balzac croit le fantastique réel, mais il n'a pas foi en lui.