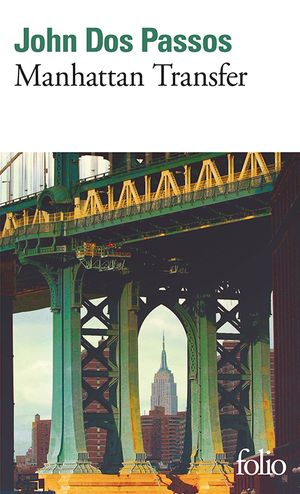Manhattan Tranfer : « L'œuvre occupe le 78e rang au classement des 100 livres du siècle établi par le journal Le Monde. »
« C’est en 1925 que parut Manhattan Transfer, celui par lequel, Dos Passos s’imposa comme une voix majeure de la littérature américaine. » (Télérama)
« Je tiens Dos Passos pour le plus grand écrivain de notre temps. » (Jean-Paul Sartre).
Qui, dès lors que l’on s’intéresse à la littérature américaine, peut se passer de lire Dos Passos ? Jusqu’à ce jour c’était moi.
J’ai comblé cette lacune. Mais que ce fut difficile à gravir ! Oh que c’est haut ! (Peut-être trop haut pour moi…) Car la lecture de Manhattan Tranfer est exigeante et demande une concentration extrême vu la multitude des personnages et des situations décrites. C’est une fresque immense qui nous est proposée mais pas avec une narration linéaire à la Balzac, à la façon du roman français du 19ème. Oh non ! Dos Passos se veut innovateur dans l’écriture, il adopte donc comme technique d’écriture « le flux de conscience » qui consiste à vouloir raconter à partir d'un processus de pensée. La profusion des personnages + la non continuité des actions + 500 pages + l’écriture expérimentale = une fatigue des sens du lecteur qui se sent perdu et dont la bonne volonté s’amenuise au fil des pages (un peu moins pour la troisième partie où on s’attache à quelques figures. Et pour cause, Dos Passos ayant réduit la voilure en soustrayant le nombre des protagonistes). Peut-être, pour mieux entrer dans ce roman, faut-il, en parallèle, noter sur une fiche chaque personnage entrant ?
Il y a dans ce roman de belles pages concernant la description de la ville de New York (après tout c’est le personnage principal du livre !). On sent la fourmilière qu’est la ville au premier quart du XXe siècle. La diversité des individus d'origines complètement différentes, tous ces êtres venus tenter leur chance, ces gens de passage, l’auteur nous en fait ressentir les émotions mais sans que l’on réussisse toujours à les repérer tous et à s’y attacher (j’ai peut-être été trop peu attentif).
Il y a, au bout du compte (du conte), un sentiment d’amertume qui domine car nombre de personnages connaissent de fortes désillusions. Le désenchantement est très présent à la conclusion de ce livre où l’un des remèdes indiqué semble être l’éloignement. S’éloigner de la ville, s’éloigner des autres, se transférer, se tirer de là, débarquer ailleurs…
« Dites, vous pouvez me prendre à bord pour un bout de chemin ? demande-t-il au rouquin assis à son volant.
- Vous allez loin ?
- Sais pas… Assez loin, oui. »