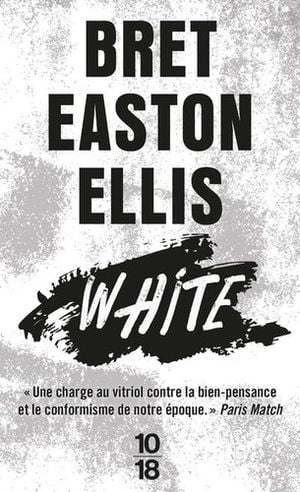Avec White (2019), Bret Easton Ellis quitte la fiction pour livrer un autoportrait sans fard, une confession en miroir d'une époque qu'il juge malade de sa vertu. L'auteur d'American Psycho ne raconte pas seulement sa vie, il radiographie la nôtre : celle d'un monde post-11 septembre, post-cinéma, post-critique, où tout se vit à travers les écrans.
Enfant des années 1970, il se souvient d'un temps plus libre, plus cruel aussi, avec des parents absents et une société qui ne protégeait personne. Les blessures forgeaient alors le caractère. Aujourd'hui, dit-il, les « parents hélicoptères » surprotègent, la société surjoue la bienveillance et fabrique des générations hypersensibles, incapables d'encaisser la contradiction.
White alterne trois récits : souvenirs autobiographiques, essai sur la mutation du cinéma américain, et chronique acide d'une époque obsédée par la moralité publique. Sur le cinéma, Ellis oppose l'âge d'or des années 70 et 80, avec ses films violents, ambigus, adultes comme Taxi Driver ou Apocalypse Now, au règne actuel des franchises Marvel, moralisatrices et infantilisantes. Cette transformation du cinéma reflète celle de la société tout entière : le passage d'une culture du risque et de la complexité à une culture du confort et de la clarté morale.
Le fil rouge du livre tient en un mot : la peur. Peur de déplaire, de choquer, de sortir du consensus. Les acteurs, les artistes, les journalistes deviennent des produits calibrés pour ne heurter personne. L'humour noir, l'ambiguïté, le doute sont bannis. Dans cette économie de la réputation où tout se note, s'évalue et s'affiche, chacun se transforme en acteur de lui-même, perpétuellement en représentation. Ellis, lui, revendique le droit au désaccord, à la dissonance, au cynisme, bref, à la liberté.
Sa critique du politiquement correct a une lucidité étouffante. Le progressisme, devenu religion morale, produit ses propres dogmes et ses hérésies. Ne pas cocher les bonnes cases, c'est s'exposer à la mise au ban : raciste, misogyne, homophobe, le tribunal des réseaux sociaux tranche sans nuance. L'auteur, qui a longtemps refusé les étiquettes identitaires avant d'assumer tardivement son homosexualité, ironise sur cette réduction où l'on attend du « gay » qu'il pense, parle et vote dans le cadre approuvé du camp du Bien. L'humour, jadis arme de défense dans un monde cruel, devient aujourd'hui suspect.
Mais c'est avec l'élection de Donald Trump qu'Ellis touche au cœur de son propos. Pour lui, le véritable drame n'est pas l'ascension de Trump, mais la réaction qu'elle a provoquée. Les médias, les artistes, les intellectuels, qui se disaient défenseurs de la liberté, ont perdu toute mesure. En s'indignant sans relâche, en criant au fascisme, ils sont tombés dans le piège qu'ils dénonçaient. Trump est devenu le révélateur d'un monde où la morale remplace la pensée, où la vertu affichée sert de stratégie de domination symbolique. Ce contre-pouvoir sourd, nourri de ressentiment et de frustration, s'est cristallisé dans les urnes : le besoin de réel, même brutal, l'a emporté sur la bienséance.
Ellis ne défend pas Trump, mais il comprend son émergence comme la conséquence logique d'un monde saturé de faux-semblants.
Au-delà de Trump et de la politique, Ellis pointe une dérive plus profonde : la disparition du réel au profit de la surface. Quand tout est accessible sans effort, le porno, la musique, la littérature, tout se vaut, tout se jette. L'effort qui donnait du prix aux choses a disparu, comme la rareté qui donnait du sens. Le monde, aplati par le numérique, s'uniformise dans une illusion de diversité.
Ellis ne cherche ni à plaire ni à convaincre. White n'est pas un manifeste politique mais une confession d'artiste désenchanté, un homme qui constate que la liberté d'expression n'est plus menacée par la censure d'État mais par la peur sociale d'être mal jugé. Sa plume rageuse, drôle et parfois injuste, rappelle qu'il est avant tout un provocateur. Mais un provocateur nécessaire.
Un livre amer, lucide, profondément humain, où Ellis interroge sans nostalgie ce qu'il reste d'authentique dans un monde saturé d'images. White, c'est le blanc de la page avant qu'on écrive, mais aussi celui du vide, celui qu'on contemple quand tout devient trop propre, trop pur, trop moral pour être vivant.
Le second mandat de Trump, en 2024, prouve l'actualité brûlante du diagnostic. Mais Ellis, dans sa charge contre le progressisme moral, sous-estime peut-être le danger symétrique : le basculement du pendule vers l'autoritarisme assumé, le mépris affiché des minorités et le cynisme érigé en politique d'État pourraient s'avérer bien plus destructeurs que la censure douce qu'il dénonce. La question reste ouverte : entre une société qui sur-moralise et une qui ne moralise plus du tout, où se situe la liberté ?