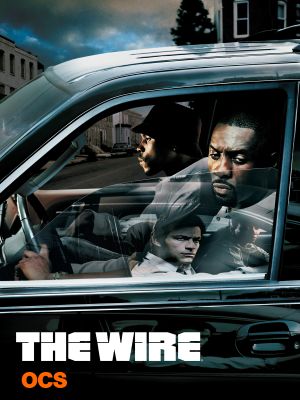Du haut des cinq années de sociologie que j’ai suivis à l’université, et du temps que j’ai passé à non seulement à découvrir le Cinéma avec un grand «C», mais également les séries considérées comme cultes, je ne retiendrais ici que deux choses : je me considère comme un faux-cinéphile, peu soucieux de l’esthétique d’une oeuvre ou de sa technique, et bien plus préoccupé par ce qu’elle cherche à exprimer, peut importe la manière utilisée (dialogues, musique ou autres) et comme un aficionado de la sociologie urbaine.
The Wire est sorti il y a plus de 20 ans et SensCritique a été lancé il y a prêt de 15 ans. Par conséquent, je ne souhaite avoir la prétention d’apporter quelque chose qui n’aurait été dit par tous les sériephiles présents ici, bien plus légitimes que moi comme dit plus haut. Et ça tombe bien, parce que dès le premier épisode j’ai cessé de regarder une série, et je suis redevenu l’étudiant en socio progressivement engouffré dans la découverte d’un nouveau terrain, que j’avais pu être durant mes études, qui avait donné laissé la place à un être pétri de certitudes et hâté par la mise en pratique de ses connaissances (Cc France Travail).
La sociologie urbaine couvre un champs très vaste, de l’étude critique de l’urbanisme, aux découpages entre quartiers (riches, pauvres, noirs, blancs, zones économiques, zones d’habitats, friches etc.), mais aussi les relations entre les différents groupes sociaux et leurs représentations de l’espace respectives pouvant aboutir à des tensions au sein d’un même espace (entre politiques, habitants, marginaux, bandes de jeunes, dealers etc.) ou encore, les politiques relatives à la gestion de l’espace urbain (politiques jeunesse, sociales, économiques urbanistique etc.).
Toutes ces dimensions constituent le phénomène urbain. Autrement dit, même si certaines sont plus visibles que d’autres (on peut voir la différence entre un quartier riche et un quartier pauvre de manière empirique, mais il est plus difficile de voir des représentations de l’espace à moins de montrer en quoi elles se matérialisent par des différences en matière d’usage ou de discours, et encore, cette démonstration ne sera que théorique), l’oeil averti saura que la ville qui lui apparaît uniquement sous sa forme brut (les bruits, les odeurs et les formes) est en réalité bien plus que ça.
Le citadin moyen se content bien souvent de pratiquer la ville, et même en général, on ne cherche pas forcément à penser en profondeur ce dans quoi nous passons notre vie, immergée, comme la ville, l’espace, la famille, le temps, le langage etc.
Si The Wire est une série atypique c’est parce que selon moi elle traduit à sa manière le travail du sociologue qui consiste à partir d’une situation particulière, pour mettre en exergue un fait social. Ainsi, The Wire n’est pas réaliste comme l’est Generation Kill dans le sens ou elle ne cherche pas à reproduire des situations spécifiquement vécues par des individus identifiés (en l’occurence, les marines appartenant au 1st Reconnaissance Battalion lors de l’opération liberté irakienne), mais à montrer en quoi les histoires de chacun, leurs interactions, leurs comportements etc. sont tout autant déterminés par, que pour le contexte (la ville).
The Wire est une série qui se veut réaliste, chose difficilement contestable au vu non seulement des retours qui lui ont été fait, mais également quand on sait qu’elle est basé sur le journal de terrain de David Simon, qui a passé une année en immersion au sein de la Brigade criminelle de la police de Baltimore dans le cadre de son travail de journaliste. Et si on peut considérer que certains aspects dits « réalistes » de l’œuvres peuvent être discutés comme Omar Little, qui dans la réalité n’aurait probablement pas tenu un épisode,, la série a le mérite d’être honnête dans le sens où elle nous rappelle à la fin de l’épisode 8 de la cinquième saison que ce dernier n’est qu’un anonyme, un simple fait divers comme il en existe tant d’autres et qui ne mérite pas d’avoir son nom à la dernière page du torchon local. Si Omar importe c’est parce que nous l’avons connu du temps de manière quasiment intime. Mais pour le médecin légiste, pour le journaliste et pour la ville elle-même, Omar Little n’est qu’un simple BNBG. Et son cas s’applique également aux trafiquants, aux politiques, à celui qui moucharde comme à celui qui se pique.
D’un point de vue sociologique, si les parcours individuels important, ce n’est pas tant en raison de leur singularité que parce qu’ils permettent de situer le réseau dans lequel chaque acteur se positionne et d’inscrire les phénomènes sociaux à l’œuvre dans un enchaînement de cause à effet. Et The Wire réussi tout aussi bien à mettre en valeur chaque personnage et ce qui lui donne sa force d’un point de vue scénaristique qu’à mettre en lumière les processus qui y sont à l’oeuvre.
La série fait le choix de ne pas rentrer dans une logique subjectiviste (le sujet est responsable de ce qu’il fait) ou déterministe (le sujet est déterminé par son environnement) bien trop simplistes, mais de montrer à partir de situations spécifiques ce qui produit de nouvelles situations (un jeune de 13 ans qui se fait assassiner par ses copains à peine plus vieux que lui, des policiers qui utilisent des moyens détournés pour remplir leurs objectifs, un politicien qui se fait élir, un autre qui échappe à la justice, un jeune qui tombe dans la drogue etc.). le résultat étant in fine la ville.
Même si ces situations ne sont pas représentatives de ce que je vis dans mon quotidien, ma ville et les villes en général n’en restent pas moins fragmentés spatialement et socialement. Les décisions politiques à l’origine de l’état désastreux de certains quartiers, d’un manque de budget pour les politiques sociales ou jeunesse, la violence de certains jeunes à peine sorti de l’enfance, la déconnexion entre forces de l’ordre et habitants, les quartiers ou règnent le monopole des criminels au détriment de ses habitants victimes de violence et d’intimidation, la mise au premier plan des dockers dans le cadre du trafic international, ou la mise en réseau des groupes criminels. De manière plus ou moins éloigné de notre quotidien, tout s’interconnecte, de l’individu au collectif, du micro-sociologique au macro-sociologique, la ville est une oeuvre collective. Et il nous importe à nous, citadins moyens de nous la réapproprier. Quitte à avant cela, prendre la peine de nous y intéresser et de décortiquer les mécanismes qui y sont à l’œuvre.
NB : J'ai pas un doctorat donc c'est plus un retour à chaud qu'un essai. M'en veuillez pas si c'est pas digne d'un sociologue à proprement parler.