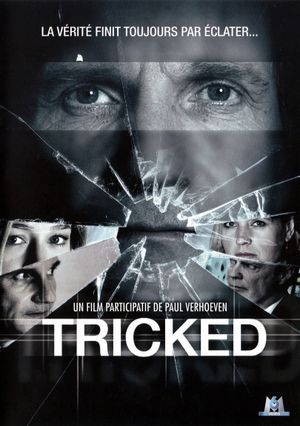Avec Steekspel, projet au scénario participatif, Paul Verhoeven retrouve les Pays-Bas et, avec eux, la veine plus néoréaliste de son cinéma après un séjour à Hollywood placé sous le signe du blockbuster. Ses personnages semblent avoir grandi avec lui, en témoigne le choix d’un protagoniste principal père de famille, là où les héros de Turkish Delight (1973) ou Spetters (1980) étaient des adolescents confrontés aux responsabilités de la vie d’adultes. Aussi regarde-t-il la jeune génération avec beaucoup d’humour et de tendresse : le second degré permanent, l’instabilité émotionnelle, la liberté des corps et de la parole face à des parents habitués à sauver les apparences, à étouffer ce qui saute aux yeux mais ce qui ne doit rester de l’ordre de la rumeur.
Le film est une vaste querelle familiale au sein de laquelle se répercutent les intérêts des collègues de travail, suivant l’idée que de la réussite professionnelle de Remco dépend la survie matérielle de sa famille bourgeoise. Il se situe entre une franche critique de ce milieu, à la Chabrol, et un savoureux jeu de massacre tel qu’il était orchestré, entre autres, par Festen (Thomas Vinterberg, 1998), fort d’une réalisation précise quoique peu délicate. Le récit épouse la forme d’un étau qui se resserre progressivement, prenant au piège un homme qui, néanmoins, ne cède jamais ni à la panique ni à la détresse ; nulle fatalité ici, mais la défense et l’illustration de la cellule conjugale comme dernier rempart au chaos, que Verhoeven se plaît à révéler dans sa complicité et sa duplicité fondamentales. La clausule, pied de nez adressé au cliché du masculin séducteur, n’est pas sans évoquer la maréchale de Grancey mise en scène par Voltaire dans un texte parodique : « Quand j’épousai M. de Grancey, nous nous promîmes d’être fidèles : je n’ai pas trop gardé ma parole, ni lui la sienne ; mais ni lui ni moi ne promîmes d’obéir. »
Un petit film modeste mais non négligeable et bien interprété, similaire à une chronique de la vie de tous les jours.