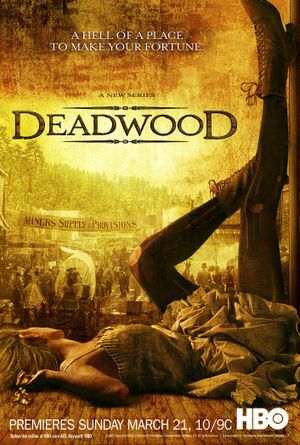Ce qui distingue Deadwood des autres séries, c’est avant tout sa langue. Rarement la télévision aura proposé un tel niveau d’ambition littéraire. En la notant 9/10, je salue d’abord un travail d’écriture à la fois audacieux, précis et profondément incarné.
David Milch ne se contente pas de faire parler ses personnages. Il leur forge une voix – âpre, poétique, souvent violente – qui sculpte l’univers de la série autant que ses décors. Les dialogues, denses et parfois cryptiques, exigent de l’attention, mais résonnent comme de véritables monologues shakespearien dans la boue du western.
Chaque tirade est une arme, chaque silence un aveu. L’écriture devient ici un terrain de pouvoir, où l’insulte se mue en art et où la rhétorique révèle les rapports de force. Swearengen, Bullock, Farnum – tous existent d’abord par la manière dont ils parlent ou se taisent.
Ce choix stylistique peut dérouter, mais c’est précisément cette audace qui confère à Deadwood sa singularité. La série ne parle pas du passé, elle l’invoque, à travers une langue morte réinventée. Une langue qui blesse, mais qui élève aussi.
Un chef-d’œuvre d’écriture, exigeant mais profondément stimulant.